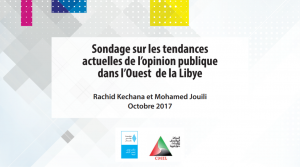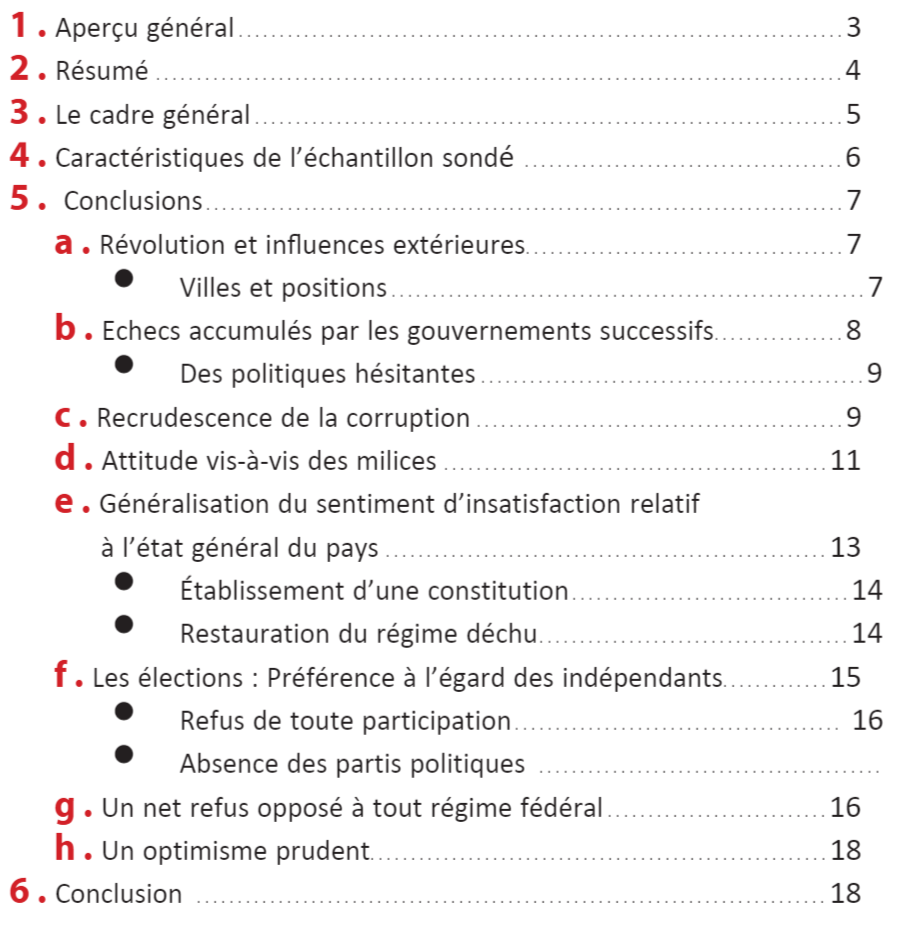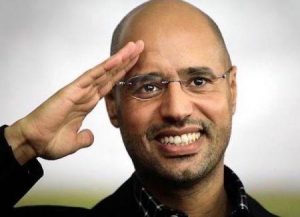Sommaire
Résumé – II
Activité du Centre Maghrébin d’études sur la Libye (CMEL)
Centre Maghrébin d’études sur la Libye (CMEL)
Invitation
Le CMEL a le plaisir de vous inviter au point de presse qu’il donne le mercredi 18 octobre 2017 à l’hôtel Africa pour présenter les résultats du Sondage d’opinion effectué récemment dans l’Ouest de la Libye.
Programme
09.00 -09.10: Mot de bienvenue du CMEL
09.00-09.20 : Allocution de M.Zeyd Aldailami directeur régional de la fondation Hanns Seidel
09.20-09.40 : Le choix de l’échantillon et la méthodologie, Rachid Khechana
09.40-10.00 : Paramètres et outputs du sondage, Mohamed Jouili
10.00-10.30 : Questions et réponses
10.30-11.00 : cocktail
Méthode adoptée pour le recensement : On a opté pour la méthode des quotas selon la variation du nombre de la population et du genre pour chacune des villes (Tripoli, Zouara, Sabrata, Sormane et Ghariane). On a aussi eu recours à des observations sur le terrain et au contact direct avec les personnes interrogées.
A la question: quelles solutions préconisez-vous pour sortir de la crise actuelle
_ L’établissement d’une constitution
_ La dissolution des milices
_ L’organisation de nouvelles élections
_ La constitution d’un gouvernement de consensus
_ Le retour de Saïf el islam au pouvoir
Une nette majorité s’est dégagée pour l’établissement d’une constitution et la tenue de nouvelles élections. En revanche 10% seulement des sondés ont affirmé être partisans du retour des symboles de l’ancien régime.
Il est à noter également que les résultats du sondage ont montré un refus catégorique du fédéralisme, qui est considéré comme une partition du pays (87 %).
Les questions faisant l’objet du présent sondage revêtent une importance d’autant plus grande que le secrétaire général des Nations Unies a présenté le 20 septembre dernier un nouveau plan en vue d’un règlement pacifique du conflit en Libye qui soit le début d’une nouvelle étape. On souhaite que ce plan puisse aboutir à un consensus visant à introduire des amendements à l’accord de Skhirat, et qu’il puisse ouvrir la voie à la tenue d’élections libres et transparentes en 2018.
Argumentaire
Il est important d’apprécier et de comprendre l’attitude de l’opinion publique quant au rendement des gouvernements libyens qui se sont succédé durant les six années écoulées. L’objectif est de se faire une idée sur la façon dont l’homme de la rue perçoit les solutions et moyens susceptibles de sortir le pays de la crise dans laquelle il se débat et de mettre fin à la guerre civile.
Ce sondage intervient à un moment où la crise économique qui sévit dans le pays touche pratiquement la majorité des libyens.
Selon des rapports internationaux, 2,4 millions de libyens sur un total de 6,3 millions ont désormais besoin d’aides humanitaires.
A titre indicatif, le dernier rapport de la Banque Mondiale sur ce pays, précise que le taux de chômage élevé en Libye contribue de manière significative à son instabilité actuelle, et ce, en dépit du fait que la Libye dispose de la plus importante réserve de pétrole en Afrique.
Pour mémoire, l’économie de ce pays dépend dans une proportion de 95% des revenus du pétrole et de gaz. Pour en comprendre l’enjeu: les recettes des hydrocarbures servent à équilibrer la balance commerciale du pays, à payer les salaires des fonctionnaires du secteur public et à financer les dépenses relatives à la compensation des produits de première nécessité, les carburants et les services essentiels tels que les soins gratuits dans les hôpitaux.
Néanmoins, l’anarchie politique et sécuritaire qui a régné, dans le pays, depuis 2011 a généré une forte baisse de la production d’hydrocarbures, ce qui a occasionné une crise économique et financière aiguë. Cette crise est perceptible à travers la pénurie et les problèmes de liquidités que connaissent les entreprises publiques et privées et à travers l’épuisement des stocks de médicaments et des produits alimentaires de première nécessité.
Les combats à Sabratha vont-ils bouleverser les équilibres politiques en Libye ?

L’ancienne « capitale » libyenne des passeurs était censée devenir une vitrine. Sabratha, cité côtière située à 80 km à l’ouest de Tripoli, était jusqu’à l’été la principale plate-forme de départs de migrants vers l’Italie. Elle a cessé de l’être à la suite d’un accord, démenti par les parties mais confirmé par des sources indépendantes, entre Rome et le principal « parrain » du trafic de migrants à Sabratha, un certain Ahmed Dabbashi, dit Al-Ammu (« l’Oncle »). Le nombre de départs de canots pneumatiques chargés de migrants a de fait spectaculairement chuté, passant de quelques centaines par jour à quelques unités.
Or voilà que ce modèle, cas d’école d’un flux migratoire maîtrisé par la négociation avec les acteurs locaux, fût-elle opaque, est en train de virer au nouveau chaos. Depuis le 17 septembre, Sabratha est le théâtre de violents combats entre milices locales, dont l’un des protagonistes est le fameux Ahmed Dabbashi. Les affrontements auraient fait une quarantaine de morts, selon une source sur place. « C’est terrible, la moitié de la population a fui en périphérie », raconte un habitant joint par téléphone. Les combats ont trouvé un écho jusqu’à l’Unesco en raison de dommages infligés au site archéologique de la cité, l’une des gloires de l’héritage romain en Libye. La directrice générale de l’Unesco, Irina Bokova, a solennellement appelé, le 21 septembre, les groupes rivaux à « cesser la violence » et à « assurer la protection » du site.
Prendre pied
Si l’éclatement des combats de Sabratha retient à ce point l’attention, c’est aussi parce qu’il pourrait fournir l’occasion au maréchal Haftar, l’homme fort de la Cyrénaïque (est de la Libye), de prendre pied dans cette région de la Tripolitaine où sa présence était jusque-là limitée. L’Armée nationale libyenne (ANL) dont il est le chef suprême, dispose certes d’une base à Wattiyah, à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de Sabratha, et de solides sympathies à Zintan, à une centaine de kilomètres au sud, mais la région lui demeure globalement récalcitrante. En Tripolitaine, les autorités locales, et nombre de milices avec elles, avaient pris acte de l’installation en avril 2016 à Tripoli de Faïez Sarraj, chef du gouvernement d’« accord national » soutenu par les Occidentaux et les Nations unies. Le refus du maréchal Haftar d’entériner ce dernier n’avait pas trouvé d’écho significatif en cette Libye occidentale. Les choses pourraient-elles changer ?

A Sabratha, le conflit oppose officiellement deux groupes : le Bataillon 48 à la Chambre des opérations anti-Daech, acronyme arabe de l’Etat islamique (EI). Ces appellations sont purement formelles. Derrière le Bataillon 48 s’active en fait la milice d’Ahmed Dabbashi, issu d’une famille omnipotente de la cité. Selon un expert des questions de sécurité en Libye, préférant s’exprimer sous le sceau de l’anonymat, le Bataillon 48 aurait même été créé en début d’année « pour donner une couverture officielle légitime à Ahmed Dabbashi dans la perspective d’un futur accord migratoire avec les Italiens », ce dernier étant finalement entré en vigueur six mois plus tard. Officiellement rattaché au ministère de la défense du gouvernement de Faïez Sarraj à Tripoli, le Bataillon 48 s’est vu confier la tâche de lutter contre la contrebande locale d’essence et une zone d’intervention située à l’ouest de Sabratha. Comme par hasard, cette aire est le fief d’Ahmed Dabbashi qui assumait également, un peu plus à l’ouest, la sécurité du complexe gazier de Mellitah, copropriété de la compagnie italienne ENI.
En face d’Ahmed Dabbashi se dresse donc la Chambre des opérations anti-Daech, formellement créée en juillet par la municipalité. La structure est un conglomérat de groupes armés chargés de prolonger le combat contre l’EI après les affrontements de février 2016. L’épisode, qui avait suivi un raid américain (50 morts) contre une ferme où l’EI avait regroupé des combattants, avait vu se cristalliser une coalition de milices décidées à en finir avec la présence de cellules dormantes de l’organisation d’Abou Bakr Al-Baghdadi dans les environs de Sabratha, où transitaient des djihadistes entre Syrte et la frontière tunisienne. Le Bataillon 48 d’Ahmed Dabbashi avait été initialement intégré à cette Chambre des opérations anti-Daech. Cette étiquette « anti-Daech » n’est toutefois pas totalement innocente. Elle vise aussi à s’attirer les sympathies de la communauté internationale sans rien changer à la nature criminelle des activités – notamment la contrebande de migrants et d’essence – des milices qui composent cette vaste et lâche coalition.
Stratégie de séduction de « madkhalistes »
Les contradictions internes nourries de rivalités financières ne vont d’ailleurs pas tarder à éclater au grand jour. La montée en puissance du Bataillon 48 d’Ahmed Dabbashi qui, après avoir supervisé l’essentiel du trafic de migrants à Sabratha s’est mis à le combattre en application de l’accord secret avec Rome (générateur pour lui de multiples bénéfices) va braquer d’autres milices, dont celle d’Al-Wadi, basée à l’est de Sabratha. Cette dernière est proche des milieux salafistes issus de l’école « madkhaliste », un courant saoudien qui prône la loyauté au pouvoir en place. Les « madkhalistes », qui combattent souvent l’EI en première ligne, soutiennent le maréchal Haftar en Cyrénaïque et le gouvernement de Sarraj en Tripolitaine. Mais Haftar a apparemment une politique plus subtile que Sarraj de séduction de ces salafistes « madkhalistes ». Ainsi l’Armée nationale libyenne (ANL) a-t-elle proclamé son soutien à la milice d’Al-Wadi, liée à des « madkhalistes » pro-Haftar en Cyrénaïque, bouleversant ainsi l’équation politico-militaire dans ce littoral de la Tripolitaine. « En général, les combats entre milices sont assez brefs, ils durent un jour ou deux, souligne l’expert des questions de sécurité. Or, à Sabratha, ils durent maintenant depuis douze jours. Une telle durée ne peut s’expliquer que parce qu’il y a des soutiens extérieurs à la ville, en particulier l’ANL. »
De l’avis de tous les analystes, l’enjeu des combats de Sabratha dépasse très largement les confins de la cité. Si l’ANL de Haftar devait réussir à établir des positions à Sabratha à travers le relais de la milice d’Al-Wadi et, au-delà, d’une Chambre des opérations anti-Daech de plus en plus sensible à sa cause, l’impact résonnerait sur l’ensemble de l’ouest de la Libye. « De Sabratha, Haftar renforcerait sa pression sur Tripoli », commente un haut fonctionnaire de la capitale. Le hiérarque militaire pourrait en outre prétendre contrôler, à l’ouest de Sabratha, le complexe gazier d’ENI à Mellitah, jusque-là « gardé » par un Ahmed Dabbashi aujourd’hui en perte de vitesse.
L’ironie est que le bouleversement dont Sabratha est le théâtre aura été précipité par l’accord secret entre Rome et Ahmed Dabbashi visant à endiguer le flux de migrants subsahariens s’embarquant vers l’Italie. Avec les troubles actuels, nombre de réseaux de passeurs qui avaient fait profil bas cet été sous la pression initiale d’un Ahmed Dabbashi devenu auxiliaire des Italiens peuvent se réveiller et renouer avec le trafic. Les combats de Sabratha sont cruciaux à la fois pour la sécurité de Tripoli et la maîtrise de la migration vers l’Europe.
L’ONU ne s’opposerait pas à un retour des kadhafistes aux affaires en Libye
Selon Ghassan Salamé, délégué spécial de l’ONU pour la Libye, « les élections, qui sont le point d’arrivée du processus, doivent être ouvertes à tout le monde(…) Cela peut inclure Saïf al-Islam [Kadhafi]». La remarque vaut sans doute également pour Bechir Saleh, ex-bras droit du Guide.
Seuls les islamistes violents seraient, par nature, exclus du jeu électoral, estime Ghassan Salamé qui souhaite, par ailleurs, que l’ensemble des initiatives diplomatiques menées ci et là, se rallient à celle de l’ONU.
Dans le même temps, la France semble avoir entendu le message de l’Union Africaine qui lui reprochait ses démarches parallèles. Un colloque est organisé le 26 septembre à Paris par l’Institut Robert Schumann pour l’Europe, avec pour thème : L’Union africaine dans la recherche d’une solution pacifique au conflit qui déchire la Libye. « L’Union africaine avec son expertise sur le plan politique est parvenue à un objectif de dialogue sans exclure aucune composante du peuple libyen. Et pourtant elle est souvent le parent oublié des manifestations internationales organisées alors qu’elle devrait en être le partenaire indiscutable et indissociable.», annonce l’organisateur.
Bechir Saleh, le Libyen qui en savait trop

C’est l’homme que tout le monde veut faire parler, au grand dam de certains amis de Nicolas Sarkozy. Un septuagénaire frêle et élégant, à la peau foncée, aux yeux rieurs, aux cheveux teints en noir. Un banal père de famille ou un jeune retraité qui passe presque inaperçu, ce dont il ne se plaint pas. Bechir Saleh, ancien directeur de cabinet du leader libyen Mouammar Kadhafi, a la sagesse de penser que pour rester en vie, il n’a d’autre choix, à 71 ans, que de faire profil bas et de peser chacun de ses mots. Toutes sortes de visiteurs se sont pourtant succédé devant sa modeste maison de Johannesburg (Afrique du Sud), où il vit depuis cinq ans : des chasseurs d’avoirs en quête du trésor – réel ou fantasmé – du défunt Guide libyen, des intermédiaires français, des diplomates, des enquêteurs des Nations unies, des espions… Et même les juges parisiens Serge Tournaire et Aude Buresi, venus en avril dernier le questionner sur le financement présumé de la campagne de Nicolas Sarkozy, en 2007.
Ce jour-là, Bechir Saleh a peiné à contenir son agacement, invoquant d’entrée son « droit au silence ». Dans sa tête se bousculaient sans doute de lourds secrets politico-financiers et diplomatiques de la Libye de Kadhafi et de la France de Sarkozy. Peut-être, aussi, le souvenir de son ami Choukri Ghanem, ex-ministre libyen du pétrole, dont le corps a fini au fond du Danube, à Vienne, en 2012…
Par prudence, il nous donne rendez-vous au dernier moment. Ce sera à Melrose Arch, un centre commercial chic de Johannesburg. Un dimanche matin de septembre, le voici qui arrive au volant d’un 4 x 4 Mercedes. L’homme, c’est confirmé, ne paie pas de mine : jean, mocassins Louis Vuitton usés, veste de survêtement bleue. Il se fond dans le décor artificiel des galeries marchandes, aux antipodes de sa thébaïde de Traghen, son oasis natale du sud libyen. « Je ne me sens pas en exil, mais comme un businessman au repos, un serviteur de la Libye en réserve »,…
Libye : la France, l’UE et les réseaux criminels, main dans la main

Joanne Liu, présidente internationale de Médecins sans frontières (MSF), accuse la France et d’autres pays européens d’entretenir, via leur politique migratoire, un réseau criminel en Libye.
Le sort des migrants et des réfugiés présents en Libye interpelle à nouveau l’Europe et ses représentants. Car au-delà d’une politique funeste obsédée par le désir de repousser toujours plus loin les gens à l’extérieur des frontières européennes, quitte à obstruer les opérations de sauvetage en Méditerranée, la France et des membres de l’Union européenne entretiennent un réseau criminel.
En Libye, il est de notoriété publique que le système de détention des candidats au refuge sur le sol européen est abject. Pour appeler un chat un chat, il consiste en une entreprise prospère d’enlèvement, de torture et d’extorsion. En choisissant sciemment de contenir à tout prix les migrants en Libye, la France et les gouvernements de l’UE légitiment un tel système.
Il n’est pourtant pas concevable que des gens puissent être renvoyés en Libye aujourd’hui, comme il est intolérable qu’ils soient contraints d’y rester. MSF intervient dans les centres de détention à Tripoli depuis plus d’un an et est le témoin d’un système arbitraire de détention mais aussi d’extorsion, d’abus, de tortures et de privation que les hommes, les femmes et les enfants y subissent au quotidien.
J’étais dans quelques-uns de ces centres la semaine dernière ; j’y ai rencontré des personnes traitées comme des marchandises. Les gens sont entassés dans des pièces sombres et sales, sans ventilation. Ils vivent les uns sur les autres et défèquent sur le ciment. Les hommes nous racontent comment, par petits groupes, ils sont forcés de courir nus dans la cour jusqu’à tomber d’épuisement. Les geôliers violent les femmes avant d’exiger qu’elles contactent leurs familles, implorant qu’on leur envoie de l’argent pour qu’elles puissent s’extraire de ce cauchemar.
Toutes les personnes que j’ai rencontrées étaient en larmes, suppliant encore et encore de sortir de là.
D’aucuns ont interprété la diminution du nombre de personnes qui tentent de traverser la Méditerranée depuis la Libye vers l’Europe comme un succès dans la lutte pour sauver la vie des migrants et supprimer les réseaux de passeurs.
Sachant ce qui se passe réellement en Libye, de telles considérations relèvent au mieux de l’hypocrisie, au pire d’une complicité cynique avec le commerce organisé d’êtres humains réduits à des ballots de marchandises livrés aux mains de trafiquants.
Tout devrait au contraire être fait pour sortir au plus vite les prisonniers de ce piège infernal, leur donner accès à des mesures de protection, à des procédures d’asile et de rapatriement volontaire accélérées. Ils ont besoin d’être mis à l’abri, et de se voir offrir des voies de sortie légales.
Sans attendre, il est urgent et vital que les détenus puissent obtenir une amélioration drastique de leurs conditions d’existence en Libye. La violence qu’ils subissent doit impérativement cesser, leurs droits doivent être respectés, y compris l’accès à la nourriture, à l’eau et aux soins médicaux.
Au lieu de s’attaquer à un cercle vicieux nourri de leur propre politique, des représentants d’Etats européens et la France se sont retranchés derrière des accusations infondées à l’encontre de citoyens ou d’ONG aidant des migrants en détresse.
Comme d’autres, MSF a ainsi été accusée à plusieurs reprises de collusion avec des trafiquants au cours de ses opérations d’assistance, de recherche ou de sauvetage en mer. De qui devrait-on pourtant faire le procès ? De ceux qui cherchent à secourir des personnes en difficulté ou de ceux qui les condamnent à être traités au mieux comme du bétail ?
La situation inhumaine des migrants en Libye est entretenue par la politique de la France et des pays européens, qui a depuis des années comme objectif de repousser les gens hors d’Europe, de les maintenir hors de vue à tout prix. Les effets de l’accord entre l’Union européenne et la Turquie en 2016, ce que nous avons vu en Grèce, en France, dans les Balkans et au-delà, sont autant d’exemples de frontières toujours plus hermétiques et d’une politique de rejet toujours plus radicale.
La mobilité des personnes à l’échelle internationale doit s’organiser et non être combattue coûte que coûte : c’est le seul moyen d’éviter que les gens ne deviennent otages de réseaux de trafiquants que les dirigeants politiques prétendent vouloir démanteler.
Au récent sommet qui s’est tenu à Paris sur les migrations, les chefs d’Etat ont chanté le besoin d’assistance, l’envoi de «missions de protection» au Tchad et au Niger et le respect des droits pour les réfugiés et les migrants. Comment peut-on parler comme ça quand on sait ce qui se passe en Libye ?
Jusqu’où la France et les membres de l’Union européenne sont-ils prêts à aller pour «contrôler la migration» ? A livrer les gens aux mains de réseaux criminels financés avec l’argent européen et à fermer les yeux sur les pires des sévices ?
Libye : des dirigeants africains critiquent l’initiative d’Emmanuel Macron
De hauts responsables africains ont stigmatisé samedi à Brazzaville les “dissonances des interventions” extérieures dans les tentatives de règlement du conflit libyen, plus d’un mois après une initiative du président français Emmanuel Macron sur la Libye.
“Rien n’est plus nuisible à nos efforts de solution de la crise libyenne que la contrariété des agendas et des approches des intervenants”, a déclaré le président de la Commission de l’Union africaine (UA) Moussa Faki Mahamat en ouverture d’une réunion du comité de l’UA sur la Libye.
“Je voudrais par la voie la plus audible exprimer la forte opposition de l’Afrique à cette contrariété et ces dissonances des interventions, approches et agendas extérieurs”, a ajouté M.Moussa Faki plaidant pour une “meilleure cohésion entre les acteurs internationaux” pour éviter les “dysfonctionnements” et la “cacophonie”.
Des observateurs ont interprété ses propos comme une critique voilée envers l’initiative du président Macron, qui avait réuni à Paris fin juillet le Premier ministre libyen Fayez al-Sarraj et son rival le maréchal Khalifa Haftar.
“L’Union africaine et son comité n’ont pas d’agenda caché en Libye”, a insisté le président congolais Denis Sassou Nguesso, hôte de la rencontre en sa qualité de président de ce “comité de haut niveau” de l’UA sur la Libye.
M. Sassou Nguesso a demandé à la “communauté internationale de ne pas ignorer, comme en 2011, la voix de l’Afrique sur la question libyenne”, en référence à l’intervention franco-britannique contre le régime du colonel Kadhafi.
Le président congolais a par ailleurs “exhorté” les Libyens à un “sursaut et à “tout mettre en oeuvre pour dépasser les clivages, à vaincre les égoïsmes individuels et partisans”, lors de cette rencontre à laquelle participe le Premier ministre libyen.
Les présidents sud-africains Jacob Zuma et nigérien Mahamadou Issoufou participent également à la réunion de Brazzaville, de même que des représentants de l’Union européenne et des Nations unies, à dix jours d’une rencontre à New York en marge de l’Assemblée générale des Nations unies.
Libye. Le Drian souligne « l’engagement » de Paris en faveur d’un règlement
Lors de son déplacement en Libye ce lundi, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian a souligné « l’engagement » de la France en faveur d’un règlement.
Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, en visite lundi en Libye, a souligné l’« engagement » de la France en faveur d’un règlement dans ce riche pays pétrolier livré au chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011.

1ère étape de mon déplacement en Libye, Tripoli où j’ai rencontré le PM Sarraj et le Pdt du Conseil d’Etat Sweihli
« C’est un signal de l’engagement de la France, du Président Macron dans la volonté de contribuer à la résolution de cette crise », a indiqué Jean-Yves le Drian dans une déclaration à la presse aux côtés de son homologue libyen à Tripoli.
Première visite officielle en Libye
Cette première visite du chef de la diplomatie française en Libye, « s’inscrit dans la dynamique qui a été initiée à la Celle-Saint Cloud et que les différents acteurs libyens ont vocation à rejoindre et en particulier les acteurs institutionnels ».
Réunis fin juillet à l’initiative de la France à la Celle-Saint-Cloud, en région parisienne, le chef du fragile gouvernement d’entente nationale (GNA) Fayez al-Sarraj, reconnu par la communauté internationale, et l’homme fort de l’est du pays, le maréchal Khalifa Haftar, avaient accepté – sans la signer — une feuille de route sur un cessez-le-feu et l’organisation d’élections l’année prochaine
« Notre objectif c’est bien la stabilisation de la Libye dans l’intérêt des Libyens eux-mêmes mais aussi dans l’intérêt des pays voisins dont nous faisons en quelque sorte partie », a-t-il dit.
Pour M. Le Drian, la « stabilisation » de la Libye « passe par l’application des déclarations de la Celle-Saint Cloud, qui prévoit notamment l’amendement de l’Accord de Skhirat », signé entre rivaux libyens sous l’égide des Nations unies fin 2015, et la tenue d’élections.
« Une Libye unie »
L’objectif est « une Libye unie, dotée d’institutions fonctionnelles », une « condition pour éviter durablement la menace terroriste et permettre la réconciliation ».
« Cette démarche s’inspire totalement dans la démarche initiée par l’envoyé du secrétaire général des Nations unies » Ghassan Salamé, en « cohérence globale entre la volonté des Nations unies […], M. Salamé et les engagements pris à la Celle-Saint Cloud », a indiqué le ministre français.
Après Tripoli, M. Le Drian a annoncé qu’il se rendrait à Misrata, puis dans l’Est libyen à Benghazi et Tobrouk.Les chefs de la diplomatie allemande Sigmar Gabriel et britannique Boris Johnson se sont déjà rendus en Libye cet été.
Migrations. L’Italie paie-t-elle des milices libyennes pour bloquer les migrants ?
D’après une enquête très documentée d’Associated Press, l’Italie ne se contenterait pas de soutenir les gardes-côtes libyens pour qu’ils empêchent les départs de migrants. Elle se serait entendue, directement, avec des milices qui, jusque-là, pratiquaient le trafic d’êtres humains.
Comment expliquer que les importants flux migratoires entre les côtes libyennes et italiennes aient soudainement baissé cet été ? Le mois de juillet a vu deux fois moins d’arrivées que juillet 2016, quant au mois d’août, en date du 29, il atteignait 86 % d’arrivées en moins qu’août 2016.
Cette forte diminution, écrit Associated Press, peut s’expliquer par les conditions en mer et par le travail des gardes-côtes libyens qui, en vertu d’un accord avec l’Union européenne (UE), bloquent les départs de migrants, interceptent les bateaux, et reconduisent leurs passagers dans des centres de rétention en Libye.
« Mais elle s’explique aussi largement par des accords conclus avec les deux milices les plus puissantes de Sabratha [Al-Ammu et Brigade 48], ville côtière de l’ouest libyen d’où partent la plupart des migrants africains qui tentent la traversée vers l’Italie.”
Liaisons dangereuses
L’enquête d’Associated Press, qui a beaucoup fait parler d’elle, avance en réalité deux informations. La première concerne le gouvernement de Faiez Serraj, installé à Tripoli (l’un des gouvernements qui se disputent la légitimité en Libye), auquel l’UE fournit formations, financement et matériel en échange des opérations de blocage des migrants effectuées par ses gardes-côtes.
D’après les nombreuses sources consultées par AP, ce gouvernement de Tripoli “a payé des milices qui, jusque-là, étaient impliquées dans le trafic de migrants pour qu’elles empêchent désormais les migrants de prendre la mer”.
L’accord entre Serraj et l’UE prévoit certes que les fonds puissent financer des “activités de réinsertion par l’emploi” à l’intention des trafiquants, indique l’article. “Mais cette mission ne va sans doute pas jusqu’à permettre de les engager dans la lutte contre les migrants.” Sans compter le risque, dans le contexte du chaos libyen, que ces milices, armées et financées, “reprennent à tout moment leur trafic ou se retournent contre le gouvernement”.
La deuxième information qu’apporte cette enquête est l’implication directe de l’Italie, sans l’entremise du gouvernement Serraj.
“Le rôle de l’Italie reste à éclaircir”, admet la reporter. La version officielle est que Rome n’a conclu aucun arrangement : “L’État italien ne négocie pas avec les trafiquants”, a déclaré le ministre italien des Affaires étrangères, Marco Minniti.
Mais plusieurs sources sur place ont soutenu le contraire. Parmi elles, “deux fonctionnaires de Sabratha, l’un responsable des services de sécurité, l’autre policier, ont pourtant eux affirmé que l’Italie s’était directement entendue avec les milices”. D’après le premier, ce sont les services secrets italiens, et pas des représentants du gouvernement, qui s’en sont chargés.
“Sous-traiter la gestion des migrants à la Libye revient à les mettre en danger”
Démentie par Rome, l’information est difficile à trouver dans les journaux italiens, à l’exception d’Il Manifesto, le quotidien communiste, qui en fait sa une. Sur une photo des Premiers ministres libyen et italien et du ministre de l’Intérieur italien, il titre : “Pacte criminel” et dénonce, dans son éditorial, “le style colonial” du ministre de l’Intérieur, dont la politique consiste à “transformer une bonne partie du continent africain en camp de concentration”.
“Sous-traiter la gestion des migrants à la Libye revient à les mettre en danger”, indique également AP, évoquant les institutions internationales et organisations de défense des droits de l’homme qui, ces dernières années, “ont fait état d’atrocités commises sur des migrants placés en détention dans ce pays, qui sont victimes d’actes de torture et d’abus sexuels, voire réduits en esclavage”.
Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian est en Libye ce lundi

Un peu plus d’un mois après l’accord conclu en France entre les deux gouvernements lybiens qui revendiquent chacun le pouvoir dans le pays, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est en déplacement en Libye ce lundi, dans le but de consolider cette feuille de route.
Le ministre devait se rendre dans quatre villes dans la journée : Tripoli, où il a rencontré le chef du gouvernement d’entente nationale Fayez al-Sarraj, reconnu par la communauté internationale. Puis Misrata, Benghazi et enfin Tobrouk, ville où se trouve le siège du parlement de l’Est représenté par le maréchal Khalifa Haftar.
Assurer le suivi d’une déclaration de principe des rivaux libyens
C’est la première visite officielle du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian en Libye, elle avait été annoncée sans précision sur les dates, pour des raisons de sécurité.
Réunis à la Celle-Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) à l’initiative de la France, fin juillet, Fayez al-Sarraj et Khalifa Haftar avaient accepté une feuille de route sur un cessez-le-feu et l’organisation d’élections, sans pour autant signer le texte. « C’est cela (ndlr : cette feuille de route) qui – je l’espère – avec le soutien de nos principaux partenaires, notamment l’Italie, permettra à l’envoyé spécial de l’ONU Ghassan Salamé de parvenir à l’organisation en 2018 des élections qui marqueront le début d’une restauration effective de l’État en Libye », avait déclaré le ministre.
المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا
تعريف:
تأسس المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا في جوان - يونيو 2015 في تونس، وهو أول مركز من نوعه يعمل بكل استقلالية من أجل تعميق المعرفة بليبيا في جميع المجالات والقطاعات، ويرفد بالمادة العلمية جهود المجتمع المدني في ليبيا لإقامة الحكم الرشيد، المبني على التعددية والتداول السلمي واحترام حقوق الإنسان . مؤسس المركز: الإعلامي والباحث التونسي رشيد خشانة يقوم المركز بنشر مقالات وأوراق بحثية بالعربية والأنكليزية والفرنسية، ويُقيم مؤتمرات وندوات علمية، وباكورة نشاطاته ندوة حول "إسهام المجتمع المدني في إعادة الاستقرار والانتقال الديمقراطي بليبيا" يومي 5 و6 أكتوبر 2015 بتونس العاصمة.
موقع "ليبيا الجديدة"
موقع إخباري وتحليلي يبث الأخبار السريعة والتقارير السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية عن ليبيا، ديدنُه حق المواطن في الإعلام، ورائدُه التحري والدقة، وضالتُه الحقيقة، وأفقهُ المغرب العربي الكبير. يتبنى الموقع أهداف ثورة 17 فبراير ومبادئها السامية ويسعى للمساهمة في بناء ليبيا الجديدة القائمة على الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والحكم الرشيد.