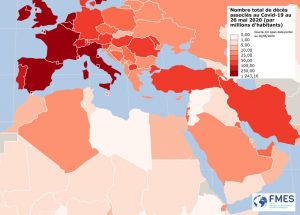L’Irlandais a été contraint de quitter son poste, éclaboussé par une affaire de politique intérieure pour non-respect des règles sanitaires liées à l’épidémie.
Le «golfgate» emporte Phil Hogan, le commissaire européen au Commerce
L’Irlandais Phil Hogan a remis sa démission mercredi soir à Ursula von der Leyen. Le commissaire au Commerce, et poids lourd de l’exécutif communautaire, qui, la veille encore, affirmait sur les ondes de la télévision publique irlandaise RTE qu’il n’avait aucune intention de remettre son mandat, a manifestement été lâché par la présidente de la Commission, comme en témoigne le très sec et très bref message qu’elle a publié pour le remercier de son travail, un service minimum. L’épisode n’est pas anodin : neuf mois après sa prise de fonction, Von der Leyen donne l’impression désastreuse d’avoir cédé aux pressions d’un gouvernement qui exigeait la peau de «son» commissaire, éclaboussé dans une affaire de politique intérieure.
Scandale
L’opinion publique, la classe politique et les médias irlandais se sont déchaînés contre les 82 personnes, dont de nombreux responsables politiques, mais aussi des représentants du monde judiciaire et des médias, qui ont participé à un dîner de gala organisé le mercredi 19 août dans un hôtel de Clifden, dans l’ouest de l’Irlande, pour célébrer le cinquantième anniversaire de l’Oireachtas Golf Society, le club de golf du Parlement. Joueur de golf émérite, ancien député et ministre, Phil Hogan ne pouvait manquer cet événement mondain. Problème : la veille, le gouvernement irlandais venait d’interdire les rassemblements en espace fermé de plus de 15 personnes (contre 50 depuis juin). Autant dire que les deux jauges ont été dépassées. Surtout, des vidéos ont montré que la distanciation physique et le port du masque n’étaient pas respectés par une partie des invités alors qu’il s’agissait d’un espace confiné.
Le scandale causé par ce «Golfgate» a été tel, dans un pays qui souffre de mesures sanitaires parmi les plus dures de l’Union européenne, trois comtés ayant été replacés en confinement cet été, que plusieurs personnalités, dont le ministre de l’Agriculture, Dara Calleary, et le vice-président du Sénat, Jerry Buttimer, ont remis leur démission.
Faux pas
D’autres, dont Hogan, ont présenté leurs excuses. Mais dans le cas du commissaire, cela a été jugé insuffisant par le gouvernement et en particulier par le vice-premier ministre, Leo Varadkar, qui dirige le parti de centre-droit Fine Gael. Il faut dire que l’homme de 60 ans a multiplié les faux pas : la police a révélé avoir arrêté le commissaire le 17 août alors qu’il se rendait dans le comté de Galway en venant de Kilkenny parce qu’il téléphonait au volant de sa voiture. Ce qui a permis d’établir que le commissaire s’était arrêté brièvement dans sa maison du comté de Kildare, situé sur son chemin, pour récupérer des documents alors que la région venait d’être replacée en confinement. Or, selon les règles locales, cela interdit tout arrêt, même dans une maison déserte.
Enfin, il s’est avéré que si Phil Hogan a bien subi un test de dépistage à son arrivée en Irlande, il n’a pas respecté la quatorzaine imposée à toutes les personnes entrant dans le pays, même en cas de test négatif… Des mesures folles, changeantes d’heure en heure, que le commissaire qui vit à Bruxelles depuis 2014 affirmait ne pas connaître faute d’en avoir été informé.
Forte pression
Reste qu’un gouvernement ne peut pas renvoyer un commissaire qu’il a nommé, celui-ci étant totalement indépendant dès sa nomination. Il peut soit démissionner de son propre chef, soit être renvoyé par la présidente de la Commission si elle juge qu’il a commis une faute grave. Face à la forte pression exercée par le gouvernement irlandais, Ursula von der Leyen a choisi de lâcher Phil Hogan.
Vers un retour du COS à Tripoli ?
Selon nos informations, l’envoi d’élements des forces spéciales (COS) à Tripoli est envisagé dans les cercles gouvernementaux et militaires français. Il s’agirait, pour les partisans de cette option, de tenter de limiter l’influence de la Turquie auprès du gouvernement d’entente nationale (GAN) dirigé par al-Sarraj. Paris mise notamment sur le ministre de l’Intérieur Fathi Bashagha, un ami de la France, qui a récemment favorisé la visite de Bernard-Henri Lévy en Libye.
Pour le commandement des opérations spéciales (COS), il s’agirait d’un retour sur place. Des hommes des forces spéciales ont en effet été envoyé sur place pour y conseiller et former les forces de sécurité locales – ainsi qu’une mission de liaison. La date de leur arrivée, comme celle de leur départ (sans doute début 2019) n’est pas publique, pas plus d’ailleurs que ne l’était leur présence sur place. Rappelons toutefois que le COS ne mènent pas des opérations clandestines. Relevant de l’état-major des armées, il est chargé de missions discrètes sur lesquelles les autorités ne communiquent guère. Les opérations clandestines relèvent uniquement de la DGSE et de son bras armé, le Service Action.
L’hypothèse de ce retour confirme l’incertitude qui règne à Paris sur la politique libyenne. La France a beaucoup misé sur le maréchal Haftar, mais son étoile pâlit… du fait de sa déroute militaire. Même s’il continue à être soutenu par les Emirats arabes unis (dont la France est très proche), certains milieux à Paris songent désormais à rééquilibrer la politique de la France en faisant un geste en direction du gouvernement reconnu par la communauté internationale.
Pendant plusieurs années, la France a entretenu deux fers au feu en Libye, avec une sorte de partage géographique. A l’ouest (Tripoli), ces militaires du COS étaient présents, de manière assez modeste. On notait aussi la présence de gendarmes du GIGN chargé de la sécurité de l’ambassadeur de France en Libye. L’Est, chez le maréchal Haftar, c’était en revanche le domaine de la DGSE et de son Service Action. Engagés dans la lutte contre Daech, les effectifs du SA ont été assez important. Le chiffre d’une centaine d’hommes a circulé mais il est, par nature, invérifiable. Certains de ces éléments clandestins ont toutefois accompagné l’offensive d’Haftar contre Tripoli en 2019, comme en témoigne la découverte de missiles français Javelin abandonnés sur place.
Tunisie : les frontières bougent

Toutes les semaines, chronique de la vie quotidienne, sociale et culturelle dans les pays arabes. Ce samedi, début d’un retour à la normale dans un pays qui patauge.
La Tunisie rouvre ses frontières ce samedi et l’imminence d’un retour (presque) à la normale traîne ses doutes, ses petites et grandes histoires – le pays, qui a plutôt bien encaissé la crise, pourra-t-il gérer sa diaspora et autres voyageurs qui reviennent ou arrivent de loin ?
Cas pratique, et répétition pour la suite : il y a une dizaine de jours, une Tunisienne, rapatriée après avoir été bloquée à l’étranger, s’est affranchie, selon les médias locaux, des règles de quarantaine (celle-ci varie en fonction de la destination, entre autres). Pour assister à un mariage. Tout y est : pandémie, égoïsme, inconscience, amour, puisque son fiancé l’aurait aidée à faire le mur. Alors qu’elle était positive au Covid-19.
Des dizaines de personnes qu’elle aurait côtoyées se sont retrouvées à l’isolement, dont les agents qui l’ont interpellée. L’imaginaire travaille fort dans ces cas-ci. On la fantasme en psychopathe capable d’embarquer des dizaines de vies avec elle pour deux déhanchés et trois sucreries. Et le raccourci aura vite fait d’être bâclé si cela vrillait cet été : ces gens de l’extérieur, Tunisiens ou pas, ne respectent pas grand-chose.
Au vrai, le pays patauge dans un jus de crâne salé. La saison touristique, qui remplit des caisses au régime sec, est compromise et le Covid-19, comme ailleurs, produit nervosité, inquiétude et par endroits, mobilisations. Dans le Sud, Tataouine bout, crispée par un marché de l’emploi famélique et des promesses non tenues.
Opacité des autorités
Depuis la révolution, des régions où se trouvent des matières premières dénoncent publiquement l’opacité de l’Etat quant à ses engagements avec des entreprises étrangères. Un manifestant, sur France 24 : «Je travaille dans un chantier, alors qu’il y a du pétrole à côté.»
A l’extérieur, la Libye, qui employait jadis des centaines de milliers de Tunisiens est une contrée dont les frontières intérieures, elles, ne sont quasiment plus définies. Russes et turcs l’ont envahie, l’Egypte veut s’en mêler. Si le voisin explose, comment la Tunisie pourra-t-elle esquiver les déflagrations ?
Kaïs Saïed, le président, était en France, quelques semaines après les débats au Parlement, dont une petite frange réclamaient excuses et réparations à l’ancienne puissance coloniale. Il rentre au pays avec une énième promesse d’aide (350 millions d’euros) et le projet d’une ligne de TGV pouvant relier le nord au sud. Il repart après avoir accordé une interview au Monde.
Pyramide molle
En théorie, il est pile là où ses jeunes électeurs l’attendaient, en l’occurrence les constats fluides : la Tunisie a de l’argent, simplement la corruption bien ancrée a tout brouillé et donné l’impression d’un Etat en délabrement continu.
En pratique, c’est plus complexe et flou. Un esprit cynique y verrait une pyramide molle, type flan : depuis des décennies, le pays dépend de promesses de l’extérieur, qui font dépendre les promesses faites aux populations à l’intérieur.
Il dit : «J’avais conseillé aux manifestants d’élaborer des projets sans attendre que l’Etat décide pour eux. Ils ne m’ont pas écouté, mais je vais les recevoir d’ici quelques jours et leur tiendrai ce même discours. Et nous allons mettre en place un plan de développement régional pour répondre à leurs besoins.» En somme de l’imiter. Après tout, il est devenu président sans structure. En s’organisant par lui-même.
Libye : le poker diplomatique de la bataille de Syrte

Les forces du gouvernement d’union nationale et celles du maréchal Haftar se font face dans l’ancien fief de Kadhafi. Mais le sort de la ville dépendra surtout de l’attitude des puissances étrangères impliquées dans le conflit.
Syrte retient son souffle. Depuis dix jours, la ville côtière du centre du pays est devenue le nœud gordien du conflit libyen. Les troupes du maréchal Haftar s’y sont retranchées après l’échec du siège de la capitale, Tripoli, et une série de revers subis dans la Tripolitaine (la province occidentale de la Libye). La contre-offensive éclair des armées loyalistes a été brutalement stoppée à l’orée de Syrte, le 7 juin, par un rideau de bombardements aériens. Depuis, les affrontements sont rares, mais chacun des deux camps accumule les hommes et le matériel en vue d’une bataille décisive.
Dans l’intervalle, la diplomatie a pris le relais. Car en Libye, la guerre se gagne en grande partie à l’étranger. Le gouvernement d’union nationale n’aurait jamais pu repousser les combattants de Khalifa Haftar sans l’aide militaire croissante de la Turquie, son principal allié, tandis que le maréchal se serait sans doute effondré sans les drones des Emirats arabes unis, les mercenaires venus de Russie et l’appui diplomatique de la France. Samedi, le principal parrain (et modèle) de Haftar, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, a menacé d’une intervention directe en Libye si les troupes loyalistes franchissaient la «ligne rouge» de Syrte à Jufra.
Propos martiaux
Jufra est une base aérienne stratégique située à 250 kilomètres au sud de Syrte, contrôlée par les forces pro-Haftar. L’armée américaine y a dénoncé le 29 mai la présence de 14 chasseurs d’origine russe. La délimitation virtuelle d’Al-Sissi revient à tracer une droite nord-sud qui coupe la Libye en deux. A l’ouest, la Tripolitaine se retrouverait sous influence turque. A l’est, la Cyrénaïque, sous protection russo-égyptienne. Les propos martiaux du président égyptien ont été qualifiés de «déclaration de guerre» par le gouvernement d’union nationale, ulcéré d’entendre une puissance étrangère dessiner des «lignes rouges» sur son territoire.
«La possibilité que l’Egypte intervienne directement augmente, mais je pense que l’administration Al-Sissi ne préférerait pas. Elle ne s’y résoudra qu’en dernier ressort. Si elle le fait, ça n’a pas besoin d’être une intervention de grande ampleur pour dissuader les forces loyalistes et les Turcs de franchir la ligne Syrte-Jufra, estime le chercheur Yezid Sayigh, du Carnegie Middle East Center, dans une interview publiée par le think tank. Je pense que la première étape pour l’Egypte sera alors de traverser la frontière en force, de façon visible, et ensuite de faire une pause. Elle marquerait ainsi sa détermination et persuaderait l’autre camp de stopper son avancée.»
Remodelage institutionnel
Ankara, galvanisée par des victoires successives autour de Tripoli, avait pourtant fait de la conquête de Syrte et Jufra une priorité. Pour les membres du gouvernement d’union nationale, elle était même considérée comme le préalable à toute signature d’un cessez-le-feu. Le Premier ministre, Faïez el-Serraj, a-t-il reçu l’approbation de Washington pour continuer l’offensive ? Il a rencontré lundi à Zouara, dans l’ouest, le chef du Commandement américain pour l’Afrique (Africom), le général Stephen Townsend, et l’ambassadeur Richard Norland. Une visite de haut niveau, relativement rare et immédiatement présentée par Tripoli comme un soutien tacite à ses opérations. Le communiqué de l’ambassade américaine est pourtant très prudent : «Il est nécessaire de mettre fin aux actions militaires et de retourner aux négociations», indique-t-il sobrement, sans préciser le sort de Syrte et Jufra.
De quelle négociation parle-t-on ? L’initiative dite «du Caire», formulée par le président du Parlement libyen Aguila Saleh, allié de Haftar, et qui prévoit un remodelage institutionnel de la Libye, a été sèchement rejetée par Tripoli. Celle des Nations unies, enlisée depuis des mois à Genève, pourrait en revanche être réactivée – c’est ce qu’aurait officiellement demandé le général Townsend à Faïez el-Serraj. Elle comporte trois volets (économique, politique et militaire). Nul doute que si les deux parties se mettent autour de la table, la ligne de cessez-le-feu y sera âprement discutée.
«Jeu dangereux»
Emmanuel Macron a profité de la venue du président tunisien Kaïs Saïed à Paris, lundi, pour exprimer son inquiétude sur la situation du pays voisin. «Je considère aujourd’hui que la Turquie joue en Libye un jeu dangereux et contrevient à tous ses engagements», a-t-il dit à l’issue de l’entretien à l’Elysée, évoquant «l’inquiétude légitime du président Sissi lorsqu’il voit des troupes arriver à sa frontière». Syrte est pourtant situé à plus de 800 kilomètres du territoire égyptien…
La semaine dernière, des incidents navals entre les marines française et turque, au large de la Libye, avaient manqué de dégénérer. Les pays sont tous deux membres de l’Otan. Mais les Turcs convoient régulièrement du matériel militaire vers la Libye, en violation de l’embargo sur les armes décrétées par les Nations unies. Les Français, contributeurs de l’opération européenne Irini, se font fort de faire respecter cet embargo en Méditerranée. «Je vous renvoie à mes déclarations de la fin de l’année dernière sur la mort cérébrale de l’Otan, a ajouté le président français. Je considère que c’est une des plus belles démonstrations qui soient.»
La réponse d’Ankara ne s’est pas fait attendre. «Par le soutien qu’elle apporte depuis des années aux acteurs illégitimes [le maréchal Haftar, ndlr], la France a une part de responsabilité importante dans la descente de la Libye dans le chaos. De ce point de vue, c’est en réalité la France qui joue à un jeu dangereux», a déclaré mardi le porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères, Hami Aksoy. Joutes verbales, menaces, conférences de presse, communiqués, déclarations… le grand poker diplomatique qui se joue dans les capitales mondiales épargnera-t-il finalement à Syrte une nouvelle bataille, ou, au contraire, jette-t-il de l’huile sur le feu ? D’un côté comme de l’autre, les Libyens n’arrivent plus à se défaire de ces encombrants parrains. Et deviennent de plus en plus spectateurs de leur propre guerre.
Libye : la France durcit le ton contre la Turquie
L’Élysée a dénoncé l’ingérence « inacceptable » et assuré que « la France ne peut pas laisser faire », dénonçant notamment l’instrumentalisation de l’Otan. Source AFP.Les tensions continuent de se multiplier autour du dossier libyen. C’est la France qui monte au créneau ce dimanche, dénonçant les actions du régime de Recep Tayyip Erdogan dans la région. Paris, qui, depuis des mois, multiplie les charges contre les ambitions régionales turques, s’est irritée d’une « politique de plus en plus agressive et affirmée de la Turquie, avec sept navires turcs positionnés au large de la Libye et une violation de l’embargo sur les armes ». « Les Turcs se comportent de manière inacceptable en instrumentalisant l’Otan, et la France ne peut pas laisser faire », ajoute la présidence française.
Emmanuel Macron s’est déjà entretenu sur ce point avec le président américain Donald Trump cette semaine, et « des échanges auront lieu dans les semaines à venir sur ce sujet avec les partenaires de l’Otan engagés sur place », ajoute l’Élysée. Le président français avait déjà regretté le silence de l’Otan, dont la Turquie est membre, envers les offensives militaires turques contre les milices kurdes en Syrie, alliées des Occidentaux dans la lutte antiterroriste en Syrie. Il avait alors affirmé, en novembre, que l’Otan était en état de « mort cérébrale ».
L’attrait des gisements gaziers
Vendredi, l’Union européenne a demandé l’appui de l’Otan pour l’aider à faire respecter l’embargo sur les armes en Libye, après avoir été empêchée par l’armée turque d’inspecter un navire suspect. Alors que les gisements gaziers offshore de la région attisent les convoitises, la Turquie soutient en Libye le gouvernement d’union libyen (GNA) de Fayez el-Sarraj, reconnu par les Nations unies. Grâce à son appui, le GNA a infligé des revers cinglants aux forces du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l’Est soutenu par l’Égypte, les Émirats arabes unis et la Russie.
La Turquie a conclu, en novembre, un accord controversé avec les autorités libyennes pour pouvoir effectuer des recherches d’hydrocarbures en Méditerranée orientale. Comme de nombreux pays riverains, la Grèce a dénoncé l’accord turco-libyen, qui étend considérablement le plateau continental de la Turquie. Ankara a aussi récemment effectué des forages exploratoires à proximité de Chypre, suscitant les protestations des pays voisins, Chypre, la Grèce, l’Égypte, ainsi que de l’Union européenne, qui a menacé la Turquie de sanctions.
Un négociant suisse soupçonné de pillage de gasoil libyen
Une ONG a déposé une dénonciation pénale pour « complicité de pillage » contre la société suisse Kolmar Group AG, soupçonnée d’avoir acheté illégalement 50 000 tonnes de gasoil libyen. Par notre correspondant à Genève, Ian Hamel
Trial International et Public Eye, deux ONG basées en Suisse, ne lâchent pas le morceau. En mars dernier, après une année d’enquête, elles révélaient un « gigantesque supermarché de la contrebande » dans une Libye en guerre depuis la chute de Kadhafi en 2011. Et l’affrontement de deux frères ennemis : Faïez Sarraj, le chef du gouvernement libyen d’accord national, et le maréchal dissident Khalifa Haftar, à la tête de l’armée nationale libyenne. En s’appuyant sur des groupes criminels et des politiciens corrompus, des traders occidentaux venaient faire leurs emplettes, siphonnant du gasoil dans les raffineries locales. Si la justice italienne a pu remonter jusqu’à Maxcom Bunkers SA, une société basée à Augusta en Sicile (plusieurs responsables de la contrebande sont actuellement en procès en Italie), en revanche, l’entreprise Kolmar Group AG, établie dans le canton de Zoug, en Suisse alémanique, échappe toujours aux radars.
50 000 tonnes de gasoil à Malte
Le 21 mai 2020, Trial International a donc déposé une dénonciation pénale pour « complicité de pillage » contre Kolmar Group AG auprès du ministère public de la Confédération (MPC). Dans un communiqué, l’ONG précise que le carburant était détourné des cuves libyennes grâce à la complicité d’un groupe armé, transbordé depuis des bateaux de pêche libyens vers des navires affrétés par deux hommes d’affaires maltais dans les eaux internationales, puis acheminé vers Malte. Entre 2014 et 2015, Kolmar Group AG aurait acheté plus de 50 000 tonnes de ce gasoil entreposé dans les réservoirs de la capitale maltaise (tandis que Maxcom Bunker SA récupérait, de son côté, 82 000 tonnes).
Ne pas chercher des poux dans la tête
Pour Trial International, « si une entreprise achète des matières premières volées à un pays en guerre en connaissance de cause, elle peut être reconnue coupable de complicité de pillage, un crime de guerre tant selon le statut de Rome de la Cour pénale internationale que d’après le droit pénal suisse ». L’ONG ajoute qu’elle espère que le ministère public de la Confédération « fera lui aussi toute la lumière sur cette affaire ». Car, jusqu’à présent, la justice helvétique ne s’est jamais montrée très pugnace vis-à-vis des sociétés de négoce. Sachant que près de la moitié du pétrole extrait dans le monde et plus de 60 % des minerais et métaux sont négociés dans la Confédération, la priorité n’est guère de leur chercher des poux dans la tête, et de raboter leurs avantages fiscaux. Pas question d’effaroucher la poule aux œufs d’or.
4 % du PIB de la Suisse
Face à l’attractivité des places asiatiques et de Londres, la Suisse entend surtout retenir les multinationales installées sur son territoire en leur offrant des « conditions-cadres attrayantes ». Ce secteur représente 4 % du PIB du pays. En décembre 2018, alors que le Conseil fédéral (gouvernement) publiait un rapport sur le négoce d’une rare indigence, reconnaissant que le respect des droits de l’homme « reste un défi pour le secteur des matières premières », l’ONG Public Eye déplorait que les achats de pétrole que les sociétés de négoce « effectuent en milliards dans des pays où la corruption est endémique demeurent toujours secrets ». « Cinq ans d’inaction fédérale », titrait Public Eye.
Les fonds de Duvalier et Mobutu
En avril 2020, après la publication de l’enquête, Kolmar Group AG (créée en 1997 et 8 milliards de dollars de chiffre d’affaires) a tenu à répondre qu’elle n’a « jamais été impliquée dans des opérations de contrebande ». De son côté, le ministère public de la Confédération confirme la réception de la dénonciation pénale envoyée par Trial International, et que « celle-ci sera examinée conformément à la procédure usuelle ».
Il convient malgré tout de rester patient. Les enquêtes sur les fonds cachés dans les banques helvétiques par les anciens dictateurs Duvalier d’Haïti et Mobutu de l’ex-Zaïre n’ont jamais abouti…
Libye : la défaite de l’Occident
Maîtres d’une partie de l’échiquier libyen, Turquie et Russie, deux puissances également asiatiques, s’installent à 500 kilomètres des côtes italiennes.
La Turquie d’Erdogan n’a pas fait semblant de s’intéresser à la Libye. Elle y a déployé des troupes pour soutenir le gouvernement reconnu par l’ONU. « Bel emplacement à saisir. Face à la Méditerranée, flanc sud de l’Europe, gorgé de pétrole et de gaz, à saisir toutes affaires cessantes. » Si on ne dénombrait pas quelque 6 500 morts pour les douze derniers mois, le dossier libyen prêterait à rire. Comme une terre vierge que des promoteurs peu scrupuleux envahiraient puis bétonneraient sans la moindre autorisation. Dans une subite accélération de l’histoire, la Turquie et la Russie, deux nations, à cheval sur les continents européen et asiatique, viennent de s’imposer sur un sol arabe et africain, à portée de longue-vue de l’Europe. Une implantation offerte sur un plateau par des Occidentaux incapables de tenir un discours et une action communs.
2011: on fête la France à Benghazi
Un peu d’Histoire récente. Dans la foulée de la Tunisie et de l’Égypte, la Libye entre dans la danse du mal nommé « Printemps arabe ». Kadhafi règne depuis quarante-deux ans, plus que les trente-sept années du tyran zimbabwéen Robert Mugabe. Furieux que son voisin tunisien Ben Ali se soit fait dégager de son poste de dictateur par une population soucieuse de dignité, le colonel rameute ses troupes et veut écraser la rébellion. L’intervention des jets français et anglais y mettra un terme. Turquie et Russie se sont à l’époque opposées à cette intervention. Dans la Libye libérée, on célèbre la France, on scande les noms de Sarkozy et de Cameron.
Officiellement, le concours de la Russie en faveur du maréchal Haftar est essentiellement aérien. Sur le terrain, des mercenaires russes sont à la manoeuvre. © Fathi Nasri
2020 : le vide géopolitique est là
Neuf ans plus tard, la fête est finie. Malgré la signature de l’accord de Skhirat en 2015, entérinant l’instauration d’un gouvernement d’entente nationale (GNA), malgré une ribambelle de conférences de paix (Berlin, Palerme, Abou Dhabi…), le vide géopolitique s’installe. Les pays européens sont incapables de s’entendre sur une position commune, faisant peu de cas du fait que la Libye est le flanc sud de leur continent. La France et l’Italie affichent leurs dissensions. La diplomatie française de Jean-Yves Le Drian joue sur les deux tableaux : la solution négociée par l’ONU tout en soutenant son principal opposant, le maréchal Haftar. Rome, qui subit des flots incontrôlés de migrants – près de 180 000 en 2016 – arrivant via des réseaux criminels sur ses plages, soutient le GNA, aussi bien le gouvernement de centre gauche de Matteo Renzi que les populistes qui lui succéderont.
La Libye désormais dans le chaos
La cacophonie européenne ajoutée à des barbouzeries baroques débouche sur une réalité tragique : la Libye sombre dans le chaos pendant que les chancelleries s’emmêlent les parapheurs. Quand de Gaulle « volait vers l’Orient compliqué avec des idées simples », ses successeurs vont sur une situation chaotique avec des arrière-pensées tarabiscotées. Un fiasco. Et c’est ainsi qu’Ankara et Moscou, fortes de leur expérience en Syrie, décident que la voie est libre. La Turquie et la Russie ont une politique claire. Ils ne se dissimulent pas derrière le paravent de la bienveillance. C’est une sale guerre, ils la feront salement : ils foncent. Et en peu de temps, les voici au centre du jeu doublant les Européens, incapables de travailler de concert, plus doués pour les sous-entendus, les calculs à triple bande qu’à mettre en œuvre une bonne vieille stratégie.
Le flanc sud de l’Europe sous protectorat russo-turc
Benoît Delmas – Ni Erdogan ni Poutine ne se sont aventurés en Libye. Ils y sont, ils y resteront. C’est du militaire, un peu, qui se transformera en politique et en commerce. Les deux nations ont déjà prouvé par le passé, notamment en Syrie, qu’ils pouvaient s’affronter, puis s’accorder. Ils auront ainsi un point de vue unique sur l’Afrique du Nord, le sud de l’Europe et le Proche-Orient. Pour les Européens, comme statufiés, c’est une défaite. Pour l’Occident, même constat. « C’est quand la marée se retire qu’on voit qui nageait tout nu » prophétisait le financier Warren Buffett, parlant affaires. On peut l’adapter aux relations internationales. Pour filer l’image maritime, 2020 sera l’année où la Méditerranée est redevenue une zone géostratégique cruciale. Pas seulement un endroit où l’on se baigne en été.
Libye : la défaite de l’Occident
LETTRE DU MAGHREB. Maîtres d’une partie de l’échiquier libyen, Turquie et Russie, deux puissances également asiatiques, s’installent à 500 kilomètres des côtes italiennes.
« Bel emplacement à saisir. Face à la Méditerranée, flanc sud de l’Europe, gorgé de pétrole et de gaz, à saisir toutes affaires cessantes. » Si on ne dénombrait pas quelque 6 500 morts pour les douze derniers mois, le dossier libyen prêterait à rire. Comme une terre vierge que des promoteurs peu scrupuleux envahiraient puis bétonneraient sans la moindre autorisation. Dans une subite accélération de l’histoire, la Turquie et la Russie, deux nations, à cheval sur les continents européen et asiatique, viennent de s’imposer sur un sol arabe et africain, à portée de longue-vue de l’Europe. Une implantation offerte sur un plateau par des Occidentaux incapables de tenir un discours et une action communs.
Un peu d’Histoire récente. Dans la foulée de la Tunisie et de l’Égypte, la Libye entre dans la danse du mal nommé « Printemps arabe ». Kadhafi règne depuis quarante-deux ans, plus que les trente-sept années du tyran zimbabwéen Robert Mugabe. Furieux que son voisin tunisien Ben Ali se soit fait dégager de son poste de dictateur par une population soucieuse de dignité, le colonel rameute ses troupes et veut écraser la rébellion. L’intervention des jets français et anglais y mettra un terme. Turquie et Russie se sont à l’époque opposées à cette intervention. Dans la Libye libérée, on célèbre la France, on scande les noms de Sarkozy et de Cameron fficiellement, le concours de la Russie en faveur du maréchal Haftar est essentiellement aérien. Sur le terrain, des mercenaires russes sont à la manoeuvre. © Fathi Nasri
Neuf ans plus tard, la fête est finie. Malgré la signature de l’accord de Skhirat en 2015, entérinant l’instauration d’un gouvernement d’entente nationale (GNA), malgré une ribambelle de conférences de paix (Berlin, Palerme, Abou Dhabi…), le vide géopolitique s’installe. Les pays européens sont incapables de s’entendre sur une position commune, faisant peu de cas du fait que la Libye est le flanc sud de leur continent. La France et l’Italie affichent leurs dissensions. La diplomatie française de Jean-Yves Le Drian joue sur les deux tableaux : la solution négociée par l’ONU tout en soutenant son principal opposant, le maréchal Haftar. Rome, qui subit des flots incontrôlés de migrants – près de 180 000 en 2016 – arrivant via des réseaux criminels sur ses plages, soutient le GNA, aussi bien le gouvernement de centre gauche de Matteo Renzi que les populistes qui lui succéderont.
La cacophonie européenne ajoutée à des barbouzeries baroques débouche sur une réalité tragique : la Libye sombre dans le chaos pendant que les chancelleries s’emmêlent les parapheurs. Quand de Gaulle « volait vers l’Orient compliqué avec des idées simples », ses successeurs vont sur une situation chaotique avec des arrière-pensées tarabiscotées. Un fiasco. Et c’est ainsi qu’Ankara et Moscou, fortes de leur expérience en Syrie, décident que la voie est libre. La Turquie et la Russie ont une politique claire. Ils ne se dissimulent pas derrière le paravent de la bienveillance. C’est une sale guerre, ils la feront salement : ils foncent. Et en peu de temps, les voici au centre du jeu doublant les Européens, incapables de travailler de concert, plus doués pour les sous-entendus, les calculs à triple bande qu’à mettre en œuvre une bonne vieille stratégie.
Russes et Turcs profitent également des absences répétées de Washington et de son management à géométrie variable. Avril 2019, Donald Trump téléphone au maréchal Haftar qui tente d’assiéger militairement Tripoli, siège du GNA. Le président américain évoque « une vision commune » entre les deux hommes, pulvérisant en quelques minutes tout soutien au GNA voulu par l’ONU. Treize mois plus tard, la ligne semble coupée entre les deux hommes. Plus de vision commune depuis que les Russes ont utilisé Haftar comme cheval de Troie pour s’installer en Méditerranée orientale. Le commandement américain en Afrique (Africom) publie, le 27 mai, un communiqué informant l’opinion que des Mig russes sont déployés dans l’Est libyen. Des photos des appareils venus de Syrie sont disponibles en pièces jointes. Mais les États-Unis ont d’autres théâtres à traiter, le chinois notamment. Ils se contenteront de fixer des lignes rouges. Alors, sans l’Oncle Sam, le brouillon européen apparaît en pleine lumière. Un brouillon aux conséquences à long terme.
Ni Erdogan ni Poutine ne se sont aventurés en Libye. Ils y sont, ils y resteront. C’est du militaire, un peu, qui se transformera en politique et en commerce. Les deux nations ont déjà prouvé par le passé, notamment en Syrie, qu’ils pouvaient s’affronter, puis s’accorder. Ils auront ainsi un point de vue unique sur l’Afrique du Nord, le sud de l’Europe et le Proche-Orient. Pour les Européens, comme statufiés, c’est une défaite. Pour l’Occident, même constat. « C’est quand la marée se retire qu’on voit qui nageait tout nu » prophétisait le financier Warren Buffett, parlant affaires. On peut l’adapter aux relations internationales. Pour filer l’image maritime, 2020 sera l’année où la Méditerranée est redevenue une zone géostratégique cruciale. Pas seulement un endroit où l’on se baigne en été.
« En Libye, la Russie mène une stratégie de “pinçage” contre l’Europe »
ENTRETIEN. Le spécialiste de la Libye Jalel Harchaoui détaille les raisons pour lesquelles Poutine renforce la présence russe en Libye. Propos recueillis par Marc Nexon
La Libye vit désormais avec une nouvelle menace : la partition. Depuis l’intervention occidentale de 2011 et la chute de Mouammar Kadhafi, le pays s’enlise dans une guerre de tranchées. Avec, dans chaque camp, deux puissants parrains. D’un côté, la Russie, dont l’intervention est de plus en plus visible. Après l’arrivée des mercenaires de la compagnie russe Wagner, ses avions de combat entrent en scène. Six Mig et deux Sukhoï auraient été déployés ces derniers jours sur la base d’Al Jufrah au cœur du désert libyen. Leur mission ? Venir en appui de « l’Armée nationale libyenne », commandée par le maréchal Haftar, l’homme fort de la Cyrénaïque, la partie orientale du pays. Un acteur également soutenu par les Émirats arabes unis et l’Égypte, mais qui semble en pleine déroute depuis son offensive manquée sur Tripoli.
En face, un autre poids lourd : la Turquie, engagée depuis novembre aux côtés du GNA, le gouvernement de Tripoli, reconnu par la communauté internationale. Un allié turc décisif, car ses drones infligent de lourdes pertes aux systèmes de défense anti-aériens d’Haftar. D’où la réaction militaire des Russes.
Chercheur au Clingendael Institute aux Pays-Bas et spécialiste de la Libye, Jalel Harchaoui décrypte les raisons pour lesquelles la Russie s’intéresse autant à la Libye.
Le Point : Les autorités françaises redoutent un scénario à la syrienne au sujet de la Libye. Qu’en pensez-vous ?
Jalel Harchaoui : C’est une erreur de comparer la Syrie à la Libye. Pour les Russes, la Syrie présente un intérêt vital. Pas seulement en raison de l’accès à la Méditerranée que leur procure leur base militaire de Tartous. Mais pour des motifs idéologiques. À leurs yeux, il était impossible de voir une révolution « islamisante » réussir à la porte du Caucase. Ils ont en mémoire leurs guerres de Tchétchénie. La Libye ne rentre pas dans ce schéma. Pour Moscou, c’est « l’étranger lointain ».
Alors quelle est la motivation russe pour s’ancrer en Libye ?
La Libye leur permet de mener une stratégie de « pinçage » vis-à-vis de l’Europe. C’est une évidence dans le domaine énergétique. Dès 2008, avant même la chute de Kadhafi, les compagnies russes avaient même fait une déclaration explicite. « Si nous pouvions, nous achèterions tout le gaz et tout le pétrole. » Autrement dit, acheter pour pouvoir contrôler ensuite. En 2017 la compagnie russe Rosneft a d’ailleurs noué des accords avec la compagnie nationale libyenne. Pourquoi ? Parce que les Russes veulent pouvoir se présenter comme une alternative aux côtés des fournisseurs d’Afrique du Nord et agir sur les flux d’énergie vers l’Europe. Pour la Russie, c’est un moyen de couvrir le flanc sud de l’Europe. De la même manière qu’elle couvre aujourd’hui le flanc est en approvisionnant notamment l’Allemagne en hydrocarbures. C’est une stratégie qui se met en place lentement, mais les Russes bâtissent ce projet pour les quinze ou vingt prochaines années. Et l’idée n’est pas nouvelle. Dans les années 1950 déjà, les dirigeants de l’URSS se reprochaient de ne pas s’intéresser assez au flanc sud de l’Otan. À son arrivée au pouvoir en 2000, Poutine avait cette ambition d’affirmer la puissance russe en Méditerranée. Mais sa marine, dans un état déplorable, ne le lui permettait pas. Aujourd’hui, il y parvient. Enfin, il y a bien sûr des intérêts commerciaux. Les Russes se souviennent que dans les années 1970 Kadhafi leur avait acheté pour plusieurs milliards de dollars d’armement. Ils veulent aussi vendre du blé et du maïs.
Pour Moscou, la Libye est devenue le symbole de l’échec de la démocratie occidentale, Y a-t-il néanmoins une explication géopolitique ?
L’autre idée cruciale des Russes, c’est que la Libye est un passage. L’Égypte est trop peuplée, l’Algérie est un mastodonte, mais la Libye est un ventre mou vers l’Afrique. S’ils perdent la Libye, ils se disent qu’ils perdent la porte d’entrée du continent. Et que leur intrusion au Soudan, au Mozambique, en Centrafrique ou à Madagascar aura du mal à se pérenniser.
Craignent-ils la réaction des Occidentaux ?
Non, ils constatent que le temps joue pour eux face à des Occidentaux désunis sur la question. Ils ont conscience d’avoir une chance extraordinaire : les Occidentaux ont totalement loupé leur intervention en Libye en 2011. Pour eux, la Libye est même devenue le symbole de l’échec de la démocratie occidentale. C’est ce qu’on entend tous les jours sur les chaînes russes. Ils exploitent cet échec.
Est-ce que la Russie ne court pas le risque de s’embourber en Libye ?
Il n’y a pas de désir de la part des Russes de mener une guerre coûteuse et de bombarder des villes libyennes durant cinq ans. Ils savent très bien qu’une guerre frontale contre la partie occidentale du pays densément peuplée et reconnue par la communauté internationale n’a aucun sens. Ce qui les pousse aussi sur le plan militaire c’est l’activisme des États du Golfe auxquels ils sont alliés. « Amenez vos mercenaires et vos avions leur demandent les Émirats. Nous sommes prêts à payer. » Pourquoi les Russes refuseraient ? D’autant qu’à chaque fois leur influence politique s’accroît un peu plus dans l’est de la Libye. Si les mercenaires russes n’avaient pas débarqué début septembre 2019, le maréchal Haftar, le chef militaire de la région orientale, se serait effondré. Il n’y a que les Russes qui peuvent faire barrage aux Turcs, engagés aux côtés des forces de Tripoli.
L’Europe et les États-Unis peuvent-ils changer la donne ?
Les Occidentaux s’affolent tout d’un coup de voir les Russes s’installer. Mais ils sont responsables de cette situation. Y compris la France. Il est trop tard pour eux. Leur passivité et leur désorganisation ont permis aux Russes de s’engouffrer. Certes, les Américains se montrent très inconstants sur ce dossier, mais ils sont à plusieurs fuseaux horaires de la Libye. Ce n’est pas le cas des Européens qui auraient dû se sentir davantage concernés.
Comment les Russes voient-ils le maréchal Haftar ?
Les relations sont très mauvaises entre eux. Les Russes se montrent sceptiques sur sa compétence militaire et sa fiabilité politique. Ils le remettent régulièrement à sa place en le court-circuitant. Je pense qu’ils veulent s’en débarrasser, mais ils n’ont pas de solution de remplacement, car Haftar a fait le vide autour de lui.
Faut-il craindre un affrontement entre la Turquie et la Russie ?
On peut l’exclure, car les deux pays se parlent. En revanche, il y aura des dérapages. Leurs hommes sur le terrain sont issus de milices et non des armées régulières. Les Russes cherchent finalement à faire à l’Est ce qu’ont fait les Turcs à l’Ouest : signer des accords de défense et prendre position.
المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا
تعريف:
تأسس المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا في جوان - يونيو 2015 في تونس، وهو أول مركز من نوعه يعمل بكل استقلالية من أجل تعميق المعرفة بليبيا في جميع المجالات والقطاعات، ويرفد بالمادة العلمية جهود المجتمع المدني في ليبيا لإقامة الحكم الرشيد، المبني على التعددية والتداول السلمي واحترام حقوق الإنسان . مؤسس المركز: الإعلامي والباحث التونسي رشيد خشانة يقوم المركز بنشر مقالات وأوراق بحثية بالعربية والأنكليزية والفرنسية، ويُقيم مؤتمرات وندوات علمية، وباكورة نشاطاته ندوة حول "إسهام المجتمع المدني في إعادة الاستقرار والانتقال الديمقراطي بليبيا" يومي 5 و6 أكتوبر 2015 بتونس العاصمة.
موقع "ليبيا الجديدة"
موقع إخباري وتحليلي يبث الأخبار السريعة والتقارير السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية عن ليبيا، ديدنُه حق المواطن في الإعلام، ورائدُه التحري والدقة، وضالتُه الحقيقة، وأفقهُ المغرب العربي الكبير. يتبنى الموقع أهداف ثورة 17 فبراير ومبادئها السامية ويسعى للمساهمة في بناء ليبيا الجديدة القائمة على الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والحكم الرشيد.