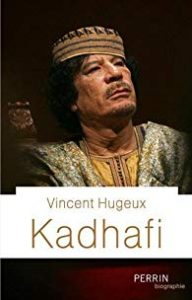Le ministre des Affaires étrangères, Khemaïes Jhinaoui, a examiné lundi soir avec l’émissaire spécial de l’ONU pour la Libye, chef de la Mission d’appui des Nations unies en Libye (Manul), Ghassan Salamé, le processus du règlement politique en Libye.
Selon un communiqué rendu public par le département des Affaires étrangères, la rencontre a permis de passer en revue les derniers développements du processus politique en Libye ainsi que les préparatifs des élections présidentielle et législatives dans ce pays.
La galère libyenne
La Libye continue, logiquement, à faire parler d’elle. Outre ses divisions politico-militaires, ce pays riche en pétrole cumule des enjeux cruciaux, caractérisés notamment par les questions d’immigration, le rôle des milices armées, les trafics et opérations de contrebande en tous genres, ou encore l’extension de l’instabilité libyenne vers la bande sahélo-saharienne. Sept ans après la chute de Mouammar Kadhafi, la Libye donne ainsi l’impression de tanguer entre deux modèles : l’un irakien, l’autre somalien. La question de la consolidation d’un nouveau modèle libyen méritait pourtant meilleur aboutissement.
La Libye paraît ne pas pouvoir non plus compter sur elle seule pour sortir de son marasme. S’il demeure souhaitable de voir les Libyens régler leurs problèmes par eux-mêmes, le fait pour eux de devoir compter sur des forces étrangères pour tenter de rapprocher leurs points de vue respectifs est difficilement évitable. Le ministre libyen des Affaires étrangères, Mohammed Taher Sayala, faisait remarquer à ce titre, lors d’une intervention récente dans les locaux de la Casa Árabe à Madrid, que les ingérences étrangères, notamment de la part de pays arabes (Qatar, Égypte, Émirats arabes unis…) en ajoutaient considérablement aux problèmes de la Libye. On comprend là que le développement par ces mêmes États de politiques plus responsables abonderait plutôt dans le sens d’une amélioration de la situation générale.
On remarquera à ce titre combien on a pu entendre, récemment, des appels à ce que l’Algérie mette plus du sien dans les évolutions libyennes. L’islamiste Ali Sallabi a exprimé ce souhait ; les Émirats arabes unis poussent aussi dans ce sens ; mais à y regarder de plus près, l’Algérie voit, elle, les choses d’un tout autre œil. Et pour cause.
On se doute de ce qu’Alger a une connaissance poussée du terrain libyen. Des considérations de type essentiellement sécuritaire expliquent cette donne ; pour les Algériens, le chaos régnant à leurs frontières se doit d’être étroitement surveillé et correctement anticipé, sous peine de pouvoir le céder à un débordement sur son propre territoire. La situation d’incertitude régnant dans le Mali, le Niger ou la Tunisie voisins, qui est liée au moins en partie au vide politique et au chaos sécuritaire sévissant en Libye, fait que l’Algérie ne veut pas hériter d’un scénario identique sur son propre territoire. Mais on peut aussi ajouter à cela un attachement de la part de l’Algérie à ne pas promouvoir de politiques pouvant polariser plus avant les perspectives libyennes.
Il y a deux ans, lorsque le ministre actuel des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, officiait encore en tant que ministre des Affaires maghrébines, il avait engagé une diplomatie tous azimuts, destinée, en premier lieu, à identifier les attentes des principaux acteurs libyens. Cela voulait-il dire que l’Algérie aurait souhaité, dans un second temps, tenter une approche diplomatique aux fins de rapprocher les points de vue des différents acteurs libyens ? On ne saurait l’exclure. Mais on ne saurait non plus l’affirmer.
La prudence diplomatique habituelle de l’Algérie pouvait difficilement le céder à d’autres réflexes, cependant que les acteurs libyens faisaient de leurs désaccords une marque de fabrique de plus en plus profonde. L’Algérie continue à avoir cette image d’acteur équidistant vis-à-vis des principaux acteurs de la scène politique libyenne ; le fait pour un islamiste (Ali Sallabi) et pour un pays anti-Frères musulmans (les Émirats arabes unis) de s’accorder sur ce qu’ils perçoivent comme une valeur ajoutée de la part de l’Algérie est une indication forte en ce sens. On en revient cependant toujours à ce sempiternel point de départ, où transparaît le fait que sept années de guerre auront plutôt fini par annihiler les espoirs sincères de paix et de réconciliation pour la Libye, sur le court terme à tout le moins.
Un fait dont même l’ONU est maintenant extrêmement consciente.
Que reste-t-il dès lors pour permettre à la Libye de se ressaisir ? Le choix n’est pas si ample : soit les acteurs politico-militaires libyens acceptent de mettre de côté leur quête du pouvoir ; soit chaos et instabilité perdureront. Ce dernier calcul est perdant, mais malheureusement il dominera pendant quelque temps encore.
Par : Barah MIKAÏL
Enseignant-chercheur à Madrid et directeur de Stracteg
Libye : le peuple regrette déjà l’époque Kadhafi
Libye: à Tripoli, sept ans après la chute de Kadhafi, une bien triste Tabaski
Dans la capitale Tripoli, la fête musulmane du sacrifice, connue en Afrique de l’Ouest sous le nom de Tabaski, représentait un jour bien triste en Libye cette année. Cette fête qui correspond aussi à la fin en 2011 du régime du colonel Mouammar Kadhafi, avait généré l’espoir d’une Libye libre et prospère, qui s’est évaporé avec la crise en cours. Sept ans après la chute du régime, l’espoir vécue par une majeure partie des Libyens a laissé la place à une grosse amertume : une mauvaise situation politique et économique sans précédent s’est installée.
Ni le gouvernement d’union nationale (GNA) de Tripoli soutenu par la communauté internationale, ni le gouvernement parallèle à l’est du pays, ni toutes les autres institutions qui s’avèrent fortement divisés et peu efficaces ne semblent pouvoir faire grand-chose pour sauver le citoyen libyen de sa souffrance quotidienne. Avec leur mission spéciale pour la Libye, les Nations unies n’arrivent pas non plus à avancer sur ce dossier.
Pendant ce temps, le citoyen libyen continue à vivre dans un pays dirigé par des milices qui pratiquent toutes sortes d’actes criminels, défendent leurs intérêts et imposent leur influence par la force des armes. Au lieu d’être intégrées par le gouvernement, ces milices, dont certaines sont composées d’extrémistes, imposent leur loi au GNA.
En plus de l’insécurité, les habitants souffrent profondément de la division politique mais aussi de l’ingérence étrangère qui participe aux divisons entre Libyens. A Tripoli, quatre grandes milices se partagent la ville et se livrent périodiquement à des combats pour marquer leur territoire.
Nostalgie de Kadhafi
Dans cette situation chaotique, la souffrance économique semble avoir le plus d’impact sur les Libyens, qui ne comptent plus le nombre d’heures passées devant les banques pour obtenir une part minime de leur salaire. Dans les files d’attente, ils sont humiliés et malmenés par les milices qui contrôlent les banques. Les banquiers avancent toujours comme excuse un manque de liquidités qui les empêche de donner leur argent à leurs clients. Et la situation s’est aggravée les jours précédents la fête de la Tabaski.
Des protestations ont eu lieu et des campagnes ont été lancées pour attaquer les banques en justice. Les Libyens essaient de trouver des solutions par eux-mêmes. Autre exemple révélateur de l’incapacité de GNA à subvenir aux besoins des Libyens au quotidien : certains commerçants font payer leurs clients avec des chèques certifiés.
Les Libyens appauvris sont plus que jamais nostalgiques de l’époque de Mouammar Kadhafi. Les Tripolitains ont ainsi découvert ce 21 août dans les rues de leur capitale des affiches défendant le fils de l’ancien leader, Saïf al-Islam al Kadhafi, qui n’est pas apparu depuis des années, et le qualifant de « Mandela de la Libye ».
Kaddafi de Vincent Hugeux
Enterré en catimini voilà six ans, après une infamante mise à mort, Muammar Kadhafi emporte alors dans sa sépulture une multitude de secrets. À commencer par
celui de sa longévité. À quel élixir ce Bédouin d’humble extraction doit-il d’avoir tenu – d’une main de fer –, quatre décennies durant, la barre du rafiot libyen ? Son implacable césarisme n’explique pas tout. L’impétueux colonel aura certes fondé son emprise sur une indéniable aura et sur sa science des alchimies tribales. Mais le pieux fils de berger, sans conteste l’un des personnages les plus déroutants et controversés du siècle écoulé, nous lègue cet autre mystère : les ressorts d’une dérive que reflète, au fil du temps, la métamorphose de son visage. Quel contraste entre les traits anguleux du jeune putschiste idéaliste, son regard ardent, et le faciès bouffi aux yeux éteints du Guide déboussolé par les bourrasques d’un Printemps fatal…
Pour cerner la psyché de celui qui se rêva héraut de l’unité arabe, fondateur d’une « théorie universelle » islamo-socialiste puis « roi des rois d’Afrique », il faut décrypter ses actes, ses discours, ses écrits, ses lubies, ses fantasmes, ses calculs ou ses innombrables volte-face. Et les passer au tamis des témoignages, souvent inédits, de celles et ceux qui ont connu, adoré ou exécré ce francophile contrarié, tour à tour « ami », cauchemar puis cible de Nicolas Sarkozy. De sa naissance énigmatique à son trépas dantesque, voici le récit d’une méharée brûlante et brutale. Le portrait du formidable acteur d’un formidable échec.
Une biographie magistrale et qui fera date, portée de bout en bout par une plume d’exception.
Libye: le chaos jusqu’où?

En dépit d’un fragile cessez-le-feu, les combats entre milices rivales au sud de Tripoli assombrissent un peu plus l’horizon.
Tiendra-t-il ? Et si oui, combien de temps ? Deux jours ? Une semaine ? Un petit mois ? Au mieux, le cessez-le-feu, accouché au forceps mardi soir sous l’égide de la Mission d’appui des Nations unies en Libye (Manul), modérera un temps l’intensité des combats qui, depuis le 27 août, opposent des milices rivales, embrasant la banlieue sud de Tripoli. Peut-être même cette accalmie précaire permettra-t-elle de rouvrir l’aéroport de Mitiga, le seul apte à desservir la capitale depuis 2014.
Pour autant, inutile de se bercer d’illusions : même si elle dépasse par sa durée la trêve précédente -laquelle, conclue sur les instances de dignitaires locaux, a volé en éclats au bout de quelques heures- celle-ci ne résoudra rien sur le fond. Près de sept ans après la chute du défunt « Guide » Muammar Kadhafi, l’ancienne Jamahiriya n’en finit plus de sombrer dans le chaos.

Une guérilla absurde et fratricide
Assauts à l’arme lourde, pluies de roquettes… Au-delà de son bilan humain (une cinquantaine de morts a minima, 1800 familles contraintes à l’exode), ce énième acte de la tragédie libyenne plongerait dans le désespoir le médiateur le plus opiniâtre. Mais il a aussi de quoi doper l’inspiration d’un dramaturge de l’absurde ou d’un maître de l’humour noir. Car les affrontements mettent aux prises, entre autres, deux factions armées réputées loyales au Gouvernement d’union nationale, ou GNA, de Fayez al-Sarraj. L’une supposément inféodée au ministère de l’Intérieur, l’autre au ministère de la Défense… Et ce sur fond, comme il se doit, d’allégeances aussi incertaines que réversibles et d’alliances à géométrie variable.
Pour un peu, on en oublierait qu’al-Sarraj doit aussi compter avec un parlement hostile, basé à Tobrouk (Est), comme avec un exécutif parallèle que soutient le maréchal Khalifa Haftar, maître des provinces orientales…
Si déroutant, voire illisible, que soit l’échiquier post-Kadhafi, la séquence en cours mérite d’être détaillée. Tout commence le 27 août, lorsqu’une milice, la 7e Brigade, quitte son fief de Tarhouna, à 60 km au sud de Tripoli, et met le cap au nord, sur l’aéroport international, dont la réouverture prochaine aiguise les appétits des porte-flingues de toutes obédiences, et que la fameuse Brigade tient pour partie intégrante de sa zone d’influence. Las !, la 7e se heurte en chemin à une coalition de milices tripolitaines, jalouses de l’emprise qu’elles exercent depuis 2016. De quoi raviver le conflit latent entre le « cartel » de la capitale et les acteurs paramilitaires qui se sentent exclus du partage de sa dépouille.

Un « pouvoir » otage des milices
Au risque d’envenimer l’affaire, Fayez al-Sarraj invite alors d’autres loups dans les ruines de la bergerie. En clair, il appelle à la rescousse les miliciens de Zintan (ouest), délogés de la capitale en 2014, et leurs ex-ennemis jurés de Misrata, la ville portuaire sitée à 190km à l’est de Tripoli, évincés quant à eux deux ans plus tard.
Cette manoeuvre à haut risque jette une lumière crue sur l’un des fléaux qui hypothèquent l’avenir du pays : faute d’avoir pu, ou su, mettre en oeuvre un accord inter-libyen signé en 2015 à Skhirat (Maroc) et censé orchestrer notamment l’intégration des miliciens au sein d’une armée nationale, faute de parvenir à asseoir son autorité, le « pouvoir » reconnu -et mollement soutenu- par la communauté internationale est devenu au fil des mois l’otage de bandes armés auprès desquelles il a sous-traité, en dépit de leur dérive criminalo-mafieuse, la sécurité de son fragile bastion tripolitain.

Comme le relève un rapport de l’ONG Small Arms Survey publié en juin, et éloquemment intitulé « La capitale des milices », ces gardes prétoriennes à la loyauté aléatoire ont infiltré et gangréné l’administration, ou ce qui en reste, les institutions de l’Etat, ou ce qui en tient lieu, et les milieux d’affaires. Si nécessaire, elles assoient leur mainmise par le harcèlement et l’intimidation. Un exemple ? Voilà peu, un fonds d’investissement souverain, exposé aux intrusions des « protecteurs » du cru, a déserté ses bureaux du centre-ville pour s’installer ailleurs. Autant dire que les objurgations de la Manul, qui enjoint au GNA de poursuivre ceux qui entravent le fonctionnement des organes étatiques, a quelque chose de surréaliste.

Le retour du spectre djihadiste
Experts en décryptage des conflits, les auteurs du rapport de Small Arms Survey redoutent l’éclosion d’un conflit d’envergure durable, dans l’hypothèse où un front d’ « outsiders » armés entreprendrait de disputer aux milices en place le contrôle de la capitale. En scellant un pacte avec d’autres mini-armées locales, ledit front pourrait de fait prendre celle-ci en étau. Autre facteur d’inquiétude, s’il en était besoin : le regain d’activisme de groupes djihadistes, terrassés hier à grand-peine, et qui tentent de profiter de la confusion générale pour reconquérir les positions perdues.
Pour le Libyen lambda, comme pour les migrants parqués dans d’épouvantables camps de rétention, ce nouvel épisode ne fait qu’assombrir un peu plus un quotidien éprouvant. L’évasion récente, à la faveur du bazar ambiant, de 400 détenus de la prison d’Ain Zara, située dans les faubourgs sud de Tripoli, attise les craintes de pillages et d’agressions. Comme si les coupures d’électricité, fréquentes et interminables, les pénuries de carburant et de cash et l’envolée des prix ne suffisaient pas… En un mois, le prix du pain, denrée de base s’il en est, a quadruplé.
Fantasmes Salvini et chimères Macron
A qui la faute ? A la France bien sûr. Et à elle seule. Telle est du moins la thèse acrobatique défendue par le ministre de l’Intérieur italien Matteo Salvini. Dans une vidéo diffusée lundi, ce démagogue d’extrême-droite fait part de sa « crainte que quelqu’un, pour des motifs économiques nationaux, mette en péril la stabilité de toute l’Afrique du Nord, et par conséquent, de l’Europe. » Mais encore ? « Je pense à quelqu’un qui est allé faire la guerre là-bas alors qu’il ne devait pas la faire, qui fixe la date des élections sans prévenir les alliés, l’Onu et les Libyens. »

Suivez mon regard et mon index accusateur. Rendons au boutefeu transalpin cette justice : quoique courageusement allusif, son réquisitoire n’est hélas pas totalement infondé. De la vaine rencontre au sommet entre al-Sarraj et Haftar, mise en scène à La Celle-Saint-Cloud (Yvelines) en juillet 2017, au sommet convoqué à l’Elysée le 29 mai dernier, le volontarisme d’Emmanuel Macron, enclin à jouer sa partition en solo, butte sur l’effroyable complexité du poker menteur perpétuel auquel se livrent, entre cupidité, égoïsme et rancunes recuites, les fossoyeurs maison.
Le très jupitérien successeur de François Hollande avait arraché en son palais une ébauche de consensus, purement verbal d’ailleurs. Il avait aussi dicté un calendrier chimérique. Pour mémoire, les protagonistes devaient s’accorder avant le 16 septembre sur les contours de la future constitution, appelée à être ratifiée par référendum, ainsi que sur la teneur d’une nouvelle loi électorale. Et ce dans la perspective de scrutins présidentiel et/ou législatif fixés au 10 décembre. Le 10 décembre, soit. Mais de quelle année ?
Rencontre entre l’UNSMIL et les maires de Tripoli pour ancrer la stabilité dans le capital
L’envoyé de l’ONU en Libye, Ghassan Salame, et la représentante humanitaire des Nations Unies, Maria Ribeiro, ont rencontré les maires du grand Tripoli pour examiner les moyens de résoudre la crise dans la capitale, en particulier après les récents affrontements dans le sud de Tripoli.
La réunion a porté sur les moyens de consolider l’accord de cessez-le-feu signé dans la ville de Zawiya sous les auspices de la MANUL et de rechercher des solutions radicales à tous les problèmes qui affligent la capitale afin de rendre cet endroit plus sûr.
Le «cartel» des milices de Tripoli aux prises avec ses rivaux

Des combats meurtriers font rage depuis huit jours dans la banlieue sud de la capitale libyenne. Un nouvel accord de cessez-le-feu a été signé dans la soirée de mardi.
Tout Tripolitain sait reconnaître immédiatement le bruit des armes lourdes. Ces brusques éruptions de violence dans les rues de la capitale viennent, à intervalles irréguliers ces dernières années, rappeler l’impasse politico-militaire dans laquelle se débat la Libye. Depuis plus d’une semaine, la ville est à nouveau le théâtre d’affrontements féroces entre milices rivales, qui ont fait au moins 50 morts et 138 blessés, selon un bilan des autorités libyennes. A Tripoli, il n’y a pas d’arbitre pour faire cesser les hostilités – deux accords de cessez-le-feu ont tenu moins d’une demi-journée. Le dernier en date, signé mardi soir sous l’égide de l’ONU, sera-t-il aussi fragile? Le gouvernement d’union nationale dirigé par Faïez el-Serraj (reconnu par les Nations unies) ne dispose d’aucune force propre : depuis son installation, en mars 2016, il est entièrement dépendant des groupes armés pour assurer sa sécurité et faire appliquer ses décisions.
Un pacte avec le diable qui a fini par tourner à son désavantage, expliquaient les chercheurs Wolfram Lacher et Alaa al-Idrissi dans une étude parue en juin (1) : «Le degré de capture de l’Etat par les groupes armés de Tripoli est sans précédent, et les groupes de personnes profitant de la fraude et des détournements, tout en occupant des postes administratifs officiels, s’est réduit à un toute petit nombre d’individus, écrivent-ils. Les milices qui contrôlent Tripoli ne sont pas loyales au gouvernement, qui est entièrement à leur merci.» Ces milices sont au nombre de quatre : la Brigade des révolutionnaires de Tripoli, dirigée par Haitem Tajouri, la force Rada, d’Abderraouf Kara, Ghneiwa, d’Abdel Ghani al-Kikli, et la brigade Nawasi. Elles constituent un redoutable «cartel» militaro-criminel, selon les chercheurs, à la fois craint pour ses méthodes expéditives et apprécié pour ses actions de police et de sécurisation au quotidien.
Cette mainmise des groupes armés de Tripoli irrite des cités rivales, notamment les puissantes villes «révolutionnaires» de Zintan et Misrata, qui tour à tour contrôlèrent des pans entiers de la capitale après la chute de Kadhafi avant d’en être expulsées. Cette fois-ci, l’assaut semble avoir été donné le 27 août par la Septième brigade, qui affirme mener une «opération de libération» afin de «nettoyer Tripoli des milices corrompues qui utilisent leur influence pour obtenir des crédits bancaires valant des millions de dollars quand les gens ordinaires dorment devant les banques pour retirer quelques dinars».
Installée à une cinquantaine de kilomètres au sud de la capitale, dans la ville de Tarhouna, la Septième brigade tente de progresser vers le nord en direction de l’aéroport international – dont la réouverture est présentée comme imminente, quatre ans après sa destruction. «Tarhouna est la seule ville de l’Ouest libyen à être contrôlée par un seul groupe armé. La Septième brigade, qui est plus communément appelée la « Kaniyat » en référence aux trois frères de la famille Al-Kani qui la dirigent, était quasiment inconnue avant 2015, décrivent Lacher et Al-Ifrissi. Depuis la mi-2017, la Kaniyat s’est agressivement étendue vers la banlieue de Tripoli. Elle va certainement revendiquer sa part du deal sécuritaire autour de l’aéroport. La Septième brigade comprend beaucoup de combattants qui ont été évincés de la capitale par le cartel – des miliciens qui veulent prendre leur revanche.»
400 prisonniers échappés
Depuis le début de l’affrontement, chacun des deux camps a réussi à agréger des alliés, décuplant l’ampleur des combats. Plus de 1 800 familles ont fui les violences, selon le gouvernement d’union nationale, tandis que 400 prisonniers se sont échappés d’une prison à la faveur du chaos. «Ces tentatives d’affaiblir les autorités légitimes libyennes et d’entraver le processus politique sont inacceptables», ont indiqué Washington, Londres, Rome et Paris dans un communiqué commun, publié samedi. Les quatre pays «exhortent tous les groupes armés à cesser immédiatement toute action militaire».
Mais le ministre de l’Intérieur italien, Matteo Salvini, a fait voler en éclat cette unanimité, mardi matin, en pointant du doigt la France sans la nommer : «Evidemment il y a quelqu’un derrière. Cela n’arrive pas par hasard. Ma crainte, c’est que quelqu’un, pour des motifs économiques nationaux, mette en péril la stabilité de toute l’Afrique du Nord et par conséquent de l’Europe, a déclaré le sulfureux ministre. Je pense à quelqu’un qui est allé faire la guerre alors qu’il ne devait pas la faire. A quelqu’un qui fixe des dates pour les élections sans prévenir les alliés, l’ONU et les Libyens.» Le Quai d’Orsay, qui pousse à l’organisation d’élections d’ici à la fin de l’année en Libye, s’est défendu publiquement : «Les efforts de la France ne sont dirigés contre personne, et certainement pas contre l’Italie, dont nous soutenons l’initiative d’organiser une nouvelle conférence sur ce dossier important pour les deux pays.» La perspective d’une élection, en revanche, semble une nouvelle fois s’éloigner.
Libye : la France fait pression pour la tenue des élections en décembre
Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, s’est entretenu lundi avec les principaux responsables politiques en Libye. Objectif : pousser à la tenue des élections au mois de décembre dans un pays toujours en proie au chaos.
« À Paris, les responsables libyens se sont engagés à tenir des élections présidentielle et législatives suivant un calendrier précis, d’ici la fin de l’année« , a-t-il martelé à l’issue d’un entretien avec le chef du Gouvernement d’union nationale (GNA), Fayez al-Sarraj, à Tripoli.
« C’est ce à quoi aspirent les citoyens libyens (..) C’est le chemin à suivre et je suis venu rappeler ces engagements et ce calendrier à ceux qui les ont pris et partager cette démarche avec ceux qui n’étaient pas à Paris le 29 mai », a souligné le ministre français des Affaires étrangères.
Des rencontres tous azimuts
Plongée dans l’instabilité depuis l’intervention militaire occidentale, la Libye est scindée en deux autorités politiques rivales, le GNA à Tripoli – reconnu par la communauté internationale – et un cabinet parallèle dans l’est du pays, soutenu par le maréchal Khalifa Haftar.
Jean-Yves Le Drian s’est rendu dans le fief de chacun des protagonistes de l’accord de Paris. Ainsi, il a rencontré Fayez al-Sarraj et le président et le président du Conseil d’Etat (chambre haute), Khlaled al-Mechri, à Tripoli, avant de s’entretenir avec le maréchal Haftar à son QG de Benghazi (est) et le président de la Chambre des représentants, Aguila Salah, à Tobrouk (est), à 1 200 km de la capitale.
Tous se sont engagés à organiser un scrutin le 10 décembre prochain et à réunifier les institutions du pays, à commencer par la banque centrale, gardienne des ressources tirées du pétrole.
La question des milices
Le « parlement de Tobrouk » doit au préalable adopter une « base constitutionnelle », définissant les pouvoirs du président, et des lois électorales d’ici au 16 septembre, en vue d’un référendum, sur la base du projet proposé par l’Assemblée constituante en juillet 2017.
« J’ai entendu la grande détermination du président Salah (…) Je n’ai aucune inquiétude ni sur sa détermination ni sur le calendrier des différentes échéances à venir », a assuré le ministre à Tobrouk.
Lors de son séjour en Libye, le ministre français a également fait halte à Misrata, une ville côtière située à 200 km à l’est de Tripoli, où des milices parmi les plus puissantes du pays font la loi. Dans cette ville, qui n’avait pas été associée au processus de Paris, Jean-Yves Le Drian a rencontré le maire Moustafa Kerouad, des élus locaux et des parlementaires.
Méfiance vis-à-vis de Paris
La France « appuie les efforts de tous ceux » qui œuvrent pour des élections, a insisté M. Le Drian qui effectuait sa troisième déplacement en Libye. Il a annoncé une contribution française d’un million de dollars (850 000 euros) pour l’organisation des scrutins.
Mais l’initiative française n’est pas partout accueillie de la même manière. Certains groupes hostiles au maréchal Haftar estiment que Paris n’est pas « neutre » et soutien l’homme fort de l’est libyen, perçu par la France comme un rempart contre le terrorisme avec son « armée nationale libyenne » autoproclamée.
« La France soutient l’ensemble des forces libyennes qui luttent contre le terrorisme partout sur le territoire (…) Ce combat nous continuons de le mener ensemble », a répliqué M. Le Drian qui a rencontré à Tripoli des unités militaires antiterroristes sous contrôle du GNA.
Une échéance encore bien incertaine
Morcelée en plusieurs entités politiques, la Libye demeure un repaire pour les groupes jihadistes, notamment Al-Qaïda au Maghreb islamique dans le sud du pays. Pour tenter de la stabiliser, la France fait le pari des élections et joue sa propre partition au risque de braquer d’autres pays impliqués en Libye, Italie en tête.
Mais l’échéance des élections demeure incertaine dans un pays où acteurs politiques et milices continuent aussi à se disputer le contrôle du territoire. Fin juin, les deux autorités rivales se sont livrées à un bras de fer autour du contrôle de terminaux pétroliers tout juste repris par les hommes de l’ANL à un chef militaire local.
« Un phénomène de déperdition »
Au fil de ces rebondissements, « il y a un phénomène de déperdition par rapport à l’ambition affichée le 29 mai », estime Jalel Harchaoui, spécialiste de la Libye.
Les milices qui craignent de perdre la main sur certaines ressources pourraient aussi être tentées de perturber la tenue d’élections.
Les pays « parrains » des différentes forces en présence – Emirats arabes unis et Egypte soutiennent le maréchal Haftar, Qatar et Turquie certains groupes islamistes – ont aussi leur propre agenda, tout comme l’Italie, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, parfois concurrents.
Contrebande : Les mafias occupent les frontières tuniso-libyennes, et l’Etat est mort !
C’est donc depuis 6 semaines que la frontière tuniso-libyenne est bloquée par les contrebandiers de Ben Guerdane dans l’indifférence la plus totale des “Autorités” tunisiennes, et le silence assourdissant et complice des médias, des “organisations nationales” et des “politiques”.
C’est depuis 6 semaines que des centaines d’entreprises tunisiennes sont empêchées d’exporter leurs biens en Libye, subissant des préjudices énormes et perdant pied sur ce marché vital.
En voici l’explication :
En Libye, on assiste à la dilapidation totale des richesses de ce pays frère par de vraies bandes organisées, s’adonnant à des trafics divers vers les pays limitrophes :
– biens et produits alimentaires compensés
– cheptel animal
– équipements et installations endommagés durant la guerre, démantelés et bradés en ferraille
– et enfin, du carburant, objet d’un trafic aux marges faramineuses (3000% et plus) dont profitent tous les voisins (Egyptiens, Tunisiens, Maltais, Italiens …), tous s’accommodant parfaitement d’un statu quo et d’une anarchie en Libye qui leur sont profitables.
Au sud tunisien, le trafic des marchandises compensées, et notamment du carburant libyen, ont permis aux contrebandiers d’amasser des fortunes colossales qui n’ont pas été réinvesties (même dans une infime proportion) dans la région pour créer des activités formelles et des emplois, mais elles ont servi à acheter des devises étrangères et surtout des biens immobiliers dans les quartiers les plus huppés de la capitale.
Le cash, qui coule à flot, a servi aussi évidemment à acheter les consciences et le silence de TOUS. Y compris ceux qui ont besoin de financements occultes et de “soutiens” locaux…
Une vraie omerta s’installe et personne n’ose désormais avouer l’évidence : à savoir qu’au sud tunisien, IL N’Y A PLUS D’ETAT, et que c’est bien le règne des mafias qui, pour protéger leur business, sont bien capables non seulement de fermer les frontières et de prendre nos entreprises et notre économie en otage, mais demain de prendre si nécessaire les armes et de mener la guerre à l’Etat !
Un gouvernement courageux et responsable se doit d’affronter fermement et de toute urgence cette situation!
Libye : force majeure sur les exportations d’un autre port pétrolier
En Libye, la société publique du pétrole, NOC, a déclaré la force majeure sur les chargements de pétrole brut dans le port de Zawiya à l’ouest, suite à une attaque et l’enlèvement de travailleurs sur l’un des plus grands champs pétrolifères du pays, Sharara.
Cette attaque, qui est survenue en fin de semaine dernière, a entrainé la fermeture de certains puits et une réduction de 125 000 barils par jour de la production du site qui est de 300 000 barils par jour. La NOC s’attend à ce que cette réduction atteigne 160 000 barils par jour, dans les prochains jours, si la situation ne revient pas à la normale. Des équipes encore présentes sur le site assurent le service minimum.
Cette insuffisance de l’offre pour le terminal d’exportation de Zawiya vient s’ajouter aux difficultés que rencontre déjà la NOC à relancer la production nationale, de façon à mieux profiter de la hausse récente des prix du brut.
La semaine dernière, la NOC a levé la force majeure sur quatre ports, dans l’est du pays, après la reprise du contrôle du croissant pétrolier par les hommes du maréchal Haftar.
المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا
تعريف:
تأسس المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا في جوان - يونيو 2015 في تونس، وهو أول مركز من نوعه يعمل بكل استقلالية من أجل تعميق المعرفة بليبيا في جميع المجالات والقطاعات، ويرفد بالمادة العلمية جهود المجتمع المدني في ليبيا لإقامة الحكم الرشيد، المبني على التعددية والتداول السلمي واحترام حقوق الإنسان . مؤسس المركز: الإعلامي والباحث التونسي رشيد خشانة يقوم المركز بنشر مقالات وأوراق بحثية بالعربية والأنكليزية والفرنسية، ويُقيم مؤتمرات وندوات علمية، وباكورة نشاطاته ندوة حول "إسهام المجتمع المدني في إعادة الاستقرار والانتقال الديمقراطي بليبيا" يومي 5 و6 أكتوبر 2015 بتونس العاصمة.
موقع "ليبيا الجديدة"
موقع إخباري وتحليلي يبث الأخبار السريعة والتقارير السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية عن ليبيا، ديدنُه حق المواطن في الإعلام، ورائدُه التحري والدقة، وضالتُه الحقيقة، وأفقهُ المغرب العربي الكبير. يتبنى الموقع أهداف ثورة 17 فبراير ومبادئها السامية ويسعى للمساهمة في بناء ليبيا الجديدة القائمة على الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والحكم الرشيد.